Les Frontières oubliées….
Ecrit par Robert-Marie MERCIER le 11 avr, 2016 dans la rubrique Histoire / Istoria | 3 commentaires
Pendant des siècles, le peuple du Comté de Nice et ceux de l’autre côté des Alpes, vivaient sur un même territoire, passant du Piémont et de la Ligurie Occidentale vers le Comté et vice-versa, sans aucun problème.
Il n’y avait pas de notion de discontinuité entre les Pays de l’Arc Alpin (anciennement Etats de la Maison de Savoie) qui se sentaient une même communauté de destin et ne connaissaient pas cette notion de frontière. Jusqu’à la trahison de 1860 qui provoqué une déchirure encore présente de nos jours. Bien des années après la séparation, due à l’annexion du Pays Niçois par l’empire de Napoléon le petit, les peuples des deux versant des Alpes conservèrent, peut-être inconsciemment, cette notion de continuité territoriale, dans leurs têtes. Nous avions, déjà relaté et état de fait dans les articles que nous avions publié, dans ce site, à propos des livres sur les Chasseurs Alpins, nos « Diables Bleus » , et de leurs rapports avec leurs alter-égos les « Alpini ». Dernièrement, après une rencontre amicale avec nos amis Ligures (qui seront présent lors de l’édition 2016 de la « Festa de la Countéa de Nissa – Païs Gavouòt e Nissart » à l’Escarène le samedi 30 et dimanche 31 juillet), Roberto Amoretti m’a envoyé un Conte Brigasque qui illustre bien les rapports particuliers et très forts qui unissent nos peuples. Nous vous livrons celui-ci suivi de sa version originale en italien.

10 juin 1940 (Conte Brigasque)
« la garde de nuit c’est d’un ennui ! » pensait le caporal Antonio Lanteri, de la Brigue
L’air est frais à 2000 mètres, à la Cima de Marta, et, celui-ci regarde le ciel étoilé du début de l’été, depuis le trou que le lieutenant a pompeusement appelé « avant-poste « .
Demain, sera une belle journée ensoleillée », pense Antonio, « si le lieutenant est dans une bonne humeur il me fera envoyer avec une des patrouilles. Je pourrai aller droit à la laune, où j’allais pêcher l’anguille avec le vieux Tugnin.
A quatre heures du matin arriva la relève et, au retour dans le dortoir, il se jeta sur son lit, tout habillé, en pensant à l’anguille gouteuse, voire à la petite mais combative truite fario, qu’il prendrait avec ses mains, en fouillant les lisses roches du fond de la laune …
C’est l’aube du 10 Juin 1940, le temps est beau, le soleil commence à sécher l’herbe humide des pâturages de Marta. Le Lieutenant sirote son café, et offre un peu de chocolat (rigoureusement autarcique 1) à ses soldats, plaisantant, en dialecte, avec le cuisinier.
Le lieutenant, Calzia de Pontedassio, est le commandant de la Compagnie et, quand il veut affirmer l’autorité du commandement, il parle italien de façon autoritaire, mais, la plupart du temps, il est plutôt détendu, et parle « cumme nui autri ». (Comme nous autres)
Le caporal Lanteri comprend que le moment est venu de se donner du courage, et se positionne en face, du lieutenant au garde à vous.
– « Mon lieutenant, le cas échéant, je suis à votre disposition pour effectuer une patrouille le long de la frontière, dans la vallée de Bendola. ».
Le Lieutenant le regarde dans les yeux et dans le regard transparent de Lanteri passe, en un instant, les images des lacs limpides, des anguilles et des truites …
Le lieutenant rit mais reprend aussitôt, après une courte pause, le masque de l’autorité, et se donne quelques secondes de réflexion, comme s’il jugeait que l’opération avait un intérêt stratégique,
– « Eh bien ! d’acccord, Lanteri, tu iras en patrouille de jour avec Rich et Di Francesco, prenez livraison des rations à l’ordinaire, retour au coucher du soleil « .
– « A vos ordres, mon lieutenant »
Antonio Lanteri peut à peine contenir la joie : une journée complète disponible, sous le ciel bleu et clair, avec la mer toujours là-bas, et les reflets dorés du soleil.
En ce sens la patrouille est une bonne chose … enfin presque, au moins pour moitié!
Le soldat Joseph Rich, de Civezza (que tout le monde appelle « Pepuccio »), paysan solide, est un ami de confiance, partenaire de nombreuses aventures, il comprend toujours tout à la volée, sans avoir besoin de parler.
En revanche, le soldat Di Francesco (dont Antonio ne peut jamais retenir le nom) vient d’un village près d’Alexandrie et est un type très cérémonieux et un peu rusé.
Il ne plait pas à Lanteri, qui sent en lui une part de fausseté … « J’aurais préféré un autre à sa place, mais tant pis, les ordres ne discutent pas, vous pensez ! »
Lanteri prend le commandement de la patrouille et décide de prendre une piste invisible qui mène au fond de la vallée, où coule la Bendola.

Pepuccio a tout compris et suit en silence.
Di Francesco continue de poser des questions : « Pourquoi allons-nous par ici … ? Mais pourquoi y aller … «
Lanteri ne répond pas : » … quel casse c.…… » pense-t-il, « il finira par se lasser de parler ! « .
Après deux heures de marche dans la forêt dense, entre les murs de calcaire gris clair, il semble voir le flux, transparent, avec des rayons lumineux qui passent à travers l’eau, et des teintes d’émeraude. Les trois soldats suivent pendant un certain temps le courant, qui, à chaque virage, s’ouvre, sous des angles uniques, sur une beauté à vous couper le souffle.
Lanteri sait que un peu plus bas il y a un étang avec un gros rocher lisse chauffé par le soleil, un coin idéal pour nager et se détendre.
Quand ils sont presque arrivé, l’oreille attentive du chasseur distingue le murmure de l’eau, et des voix.
Lanteri fait un signe de silence pour Di Francesco et ils avancent, tous trois, avec précaution: le fameux rocher est déjà occupé!
Ce sont trois garçons, en sous-vêtements, qui fument une cigarette, devisant tranquillement couchés sous les rayons du soleil. Ils sont sous le charme du lieu et, un peu plus haut, trois objets, qu’il ne parvient pas à reconnaître ainsi que trois mousquetons :
« Bon sang, des soldats français ! ».
Les trois nageurs ont également remarqué la présence étrangère, mais si forte est leur surprise, et oubliant totalement leur rôle de « défenseurs armés de la frontière », qu’ils restent là, toujours, avec leur bouche ouverte et la cigarette pendante aux lèvres.
«Et maintenant ? Que devrions-nous faire ? Soit ils sont dans leurs frontières, soit ils ont pénétré sur notre territoire ? Que devrions-nous dire à ces « presque ennemis » ? (la guerre n’est pas encore présente … mais elle se précise)(2)
Les questions qui se mélangent dans les cerveaux sont les mêmes, de chaque côté, et les six soldats restent immobiles, ne sachant quoi faire.
Après quelques secondes assez tendues, le visage Lanteri se détend : il crie « Giuanin » .
Parmi les trois français, il reconnaît son cousin Giovani, de Saorgio qui, fait son service dans les avant-postes français de la vallée de la Roja. Il avait eu l’idée de profiter, avec les deux autres soldats, de profiter un peu du soleil après avoir pris un bain dans l’étang.
Les règles complexes d’engagement, qui avaient suscité tant de réunions des état-major général, à Rome comme à Paris, sont oubliées en un instant! S’ensuit une accolade fraternelle (En territoire italien ou français ? … Bah, qui sait !)
Et, peu après, les voilà tous ensemble pour une baignade collective.
Il y avait plusieurs années qu’ils ne s’étaient vus, les deux cousins, et ils en avaient des choses à se raconter. Ils parlaient Brigasco, mais chaque fois dans un discours que captèrent les deux autres Français, l’un de Saint-Etienne de Tinée, et l’autre de Barcelonette.

La vista sus li mountagna
Pepuccio eut du mal à comprendre quelque chose, mais respectueusement silencieux,il hochait simplement la tête, heureux,surtout quand ils parlaient de femmes.
Francesco lui était nerveux: « vous ne devriez pas faire confiance à ces français » pensait il belliqueusement, « la guerre peut éclater à tout moment, et ils deviendront alors nos ennemis, nous n’aurions comme choix que de les abattre ou les faire prisonniers! ».
Antonio Lanteri est heureux, après une énième plongée dans la laune lumineuse, il s’allongea sur la roche chaude et ferma les yeux. Serait-ce sa rencontre avec son cousin, serait-ce l’odeur caractéristique et piquante des herbes de la rivière, lui revinrent à la mémoire ces moments de son enfance qu’il croyait avoir oublié …
Puis vint le temps de s’en retourner et ils se saluèrent amicalement (Demain …, là encore ? Qui sait …) puis ils se séparèrent, les Italiens par ici et les français par là.
Seulement au coucher du soleil quand, après trois heures de marche en montée, Lanteri, Rich et Di Francesco arrivent à l’ouvrage de Marta, ils apprennent la grande nouvelle de la journée : l’Italie a déclaré la guerre à la France. C’est « la guerre ! »
Lanteri fut parcouru d’un frisson dans le dos. La responsabilité de la patrouille était la sienne et si, par malheur, quelqu’un apprenait qu’il avait intercepté trois soldats français, que non seulement il ne les avait pas attaqué, mais qu’en plus ils s’étaient baignés ensemble … il serait bon pour la cour martiale.
Il croisa un instant le regard de Pepuccio et comprit qu’il ne parlerait pas.
Il se mit à chercher Di Francesco et vit qu’il était en grande conversation avec le lieutenant Calzia : « Je n’aime pas cela » pensa- t-il.
Il eut une nuit agitée, avec des rêves confus et des histoires étranges dans lesquelles se mêlaient beaucoup de personnages. La trompette sonne le réveil alors qu’il lui semble juste venir de se mettre au lit. Il se lève à contrecœur alors qu’il préférerait continuer à dormir et il a comme un mauvais pressentiment.
Le Lieutenant, Calzia avec un visage étrangement grave, lui fait comprendre qu’il veut le voir immédiatement dans son bureau.
– »A vos ordres » dit Lanteri inquiet.
– » Aujourd’hui, vous allez à la chasse aux Français » dit Calzia, en italien, d’un air sévère et péremptoire « puisque vous, caporal Lanteri, vous êtes le meilleur chasseur de la Compagnie, vous nous guiderez jusqu’à la fameuse laune, et nous verrons si nous sommes assez chanceux pour trouver un ennemi qui a eu l’effronterie de passer la frontière. « .
Lanteri se sent perdu, « l’infâme Di Francesco » a tout dit, et maintenant ce sera la cour martiale. Même le pape ne pourra me sauver. Le seul espoir est que, arrivé à l’étang, il n’y ait pas un français, mais si nous trouvons Giuanin et les autres, pour eux, ce sera fini. « .
Ce raisonnement traverse son esprit avec la vitesse de l’éclair, et, comme cela est le cas après la lueur de la foudre, l’obscurité lui semble encore plus intense, de telle sorte que le cerveau d’Antonio Lanteri se trouve plongé dans les ténèbres.
Il progresse sur le chemin comme un automate, avec un très fort sentiment de nausée, et la certitude que, étape par étape, inexorablement il s’approche d’une tragédie inévitable.
Derrière lui, marche le lieutenant Calzia, suivi par une dizaine de soldats entièrement armés.
–« C’est idiot, mais j’aurai du tenir compte de ce mouchard de Di Francesco » pense le Lieutenant, « Ils n’ont maintenant aucun moyen de s’en sortir. Espérons seulement que dans la rivière, il n’y en a pas. Je ne vais pas tirer sur des gars dans leurs sous-vêtements, ou pire encore, tirer sur ces abrutis devant moi s’ils tentent de les avertir pour les faire fuir. Si seulement il n’y avait pas de troupes derrière nous « … Antonio Lanteri se promène avec sa tête, avec son dos courbé, comme s’il portait une centaine de livres dans le sac à dos.Ses sens aiguisés et subtils, distinguent des voix venant d’en bas. Son dernier espoir, qu’il n’y ait personne à la rivière, part en fumée : « Je ne peux pas faire une chose pareille. Ne rien faire, alors ? Mais il aurait cela sur sa conscience toute sa vie. Mieux vaut la mort. Qui sait comment elle viendra ? Est elle comme l’avait décrite dit Don Mario ? … « pensait-il, en serrant son fusil.
Le bruit métallique du chien du Beretta 34 d’ordonnance du lieutenant, le fait, tout d’un coup, sortir de ses pensées et un frisson lui parcourt le dos. Il sait que cette arme est pour les Français, mais si nécessaire, il pourrait à bout portant faire feu sur lui (ce ne serait pas la première ni la dernière fois, étant bien conscient des règles absurdes de la guerre).
Le temps passe, dans quelques minutes, on sera sur les Français, se dit Antonio, avec une boule dans la gorge qui l’empêche de respirer. Il a décidé : Il va tirer un coup en l’air, pour donner l’alarme aux Français et leur permettre de se mettre en sécurité.
Il se doute de ce qui arrivera le moment suivant : un simple tir du pistolet du lieutenant, et il se retrouvera sur un autre chemin au delà des montagnes … déjà, il lui semble voir son père qui vient à sa rencontre, il semble aussi entendre le son de ses pas …
Le bruit des pas, oui, c’est maintenant beaucoup plus clair, c’est presque une course, parmi les buissons de bruyère : un sanglier, grosse tête vers le bas, qui semble terrifié et en un clin d’œil à traversé le chemin quelques mètres devant Antonio, qui appuie instinctivement sur la gâchette, sans viser.

Un rugissement a secoué les parois rocheuses de Bendola, suivie immédiatement par un tir plus faible, plus sec, presque en colère : le lieutenant a tiré !
Lanteri ferme ses yeux : « au revoir Carlotta ! », Il les rouvre, non, il n’est pas monté au ciel,il est toujours là, entouré du vert tendre des mélèzes .
Il tourne lentement la tête et regarde le lieutenant, qui le regarde dans les yeux, il est encore plus pâle que lui, avec le pistolet dans sa main dont le canon fume encore.
– « Le Sanglier » bégaie Lanteri, comme pour se justifier.
– « Hé oui, le sanglier », répond avec soulagement le lieutenant en hochant la tête.
Robertin de Perandré
– (1) Rigoureusement autarcique : Le Duce, Benito Mussolini, avait décidé que tous les produits consommés par les italiens devaient être produit par la « Terra Irredentista Italiana ».
– (2) La guerre n’est pas encore là … mais elle est dans l’air ?
L’offensive allemande commence le 10 Mai 1940, ce bouffon de Mussolini, attendra que le sort de la bataille soit fixé, pour faire connaître ses exigences territoriales sur la Tunisie, La Corse, Djibouti, la Savoie et Nice. Mais ces revendications faisaient déjà l’objet des slogans repris par les grotesques défilés de chemises noires depuis septembre 1939.
Il annoncera officiellement l’entrée en guerre de l’Italie au côté de Hitler que le 10 Juin 1940. Mais aucune offensive ne fut déclenchée sur le front des Alpes avant le 20 Juin 1940.
La demande d’armistice avait déjà été déposée et acceptée par Hitler, le 18 juin, il fallut donc repousser la durée du conflit, les allemands refusèrent l’appui de la Luftwaffe aux Italiens, et ils leur donnèrent la date limite du 25 Juin. Le Duce ne conserverait que les territoires conquis à cette date.
De nombreux officiers Piémontais, firent, alors, le minimum, dans cette offensive qui les dégoutait profondément et, pour se venger, Mussolini, les envoya avec très peu d’équipement se faire massacrer en Russie.
De nombreux cousins du Val de Roja, se retrouvèrent, de part et d’autre de cette frontière absurde créée en 1860, dans les maquis Piémontais ou Ligures dans la lutte contre les Allemands en 1944et hiver 1945 .
Le balcon de Marte, servit ainsi de lieu de parachutage destiné à l’approvisionnement des maquis.
Cette histoire conforte d’autres histoire, où les hommes de troupes (particulièrement les « Alpinis », équivalent de nos « Chasseurs Alpins ») italiens prévinrent leurs homologues français : « Ne passez pas par là, demain, nos officiers nous ont donné des ordres et on sera obligé de tirer » La réciproque existait aussi : « Quittez la bergerie de X, la position est parfaitement repérée et demain l’artillerie ouvrira le feu. »
Traduction et ajout de notes : Barbajohan.
Mise en page Robert-Marie MERCIER
10 giugno 1940
racconto brigasco
“Che noia il turno di guardia di notte!”
L’aria è fresca ai 2.000 metri di Cima Marta, ed il Caporale Antonio Lanteri, di Briga, guarda il cielo stellato di inizio estate, disteso nella buca che il Tenente chiama pomposamente “avamposto”.
“Domani sarà una bella giornata di sole”, pensa Antonio, “se il Tenente è di buon umore mi faccio mandare in pattugliamento. Voglio arrivare fin giù, al torrente, dove andavo per anguille con nonno Tugnin.”.
Alle quattro di notte arriva il cambio e, tornato in camerata, si butta sulla branda, bello vestito, pensando alle sguscianti anguille, alle piccole ma combattive trote fario, che prendeva con le mani, cingendo i levigati massi del fondo del laghetto…
E’ l’alba del 10 di giugno del 1940, il tempo è splendido, il sole inizia ad asciugare l’erba bagnata dei pascoli di Marta. Il Tenente sta sorseggiando il caffé, e offre un po’ di cioccolata (tutto rigorosamente autarchico) ai suoi soldati, scherzando, in dialetto, con il cuoco.
Il Tenente Calzia, di Pontedassio, ha il comando della Compagnia e, quando vuole far sentire il peso del comando, parla in italiano ed è piuttosto autoritario, ma in altri momenti si rilassa, e parla “cumme nui autri”.
Il Caporale Lanteri capisce che il momento è propizio, si fa coraggio, e gli si para davanti, sull’attenti:
“Signor Tenente, se lo ritiene opportuno, sono a disposizione per effettuare un pattugliamento lungo la linea di confine, nel vallone della Bendola.”.
Il Tenente lo fissa negli occhi, e nello sguardo trasparente del Lanteri passano in un attimo i chiari laghetti, le anguille, le trote…Gli scappa da ridere, al Tenente, ma mantiene la smorfia dell’autorità e, dopo una pausa di alcuni secondi, come se valutasse l’operazione sotto il profilo strategico: “Bene! Lanteri in pattugliamento diurno con Ricca e Di Francesco, consegne ordinarie, rientro entro il tramonto!”.
“Signorsì!” Antonio Lanteri riesce a malapena a contenere la gioia: una giornata intera a disposizione, sotto il cielo azzurro e terso, col mare immobile laggiù in fondo, dorato dai riflessi del sole.
Anche la compagnia è buona…, almeno per metà!
Il soldato Giuseppe Ricca, di Civezza (per tutti “Pepuccio”), solido contadino, è un amico fidato, socio di tante avventure, si capiscono sempre al volo, senza parlare.
Il soldato Di Francesco (il nome non riesce mai a ricordarlo) arriva da un paese vicino ad Alessandria, ed è un tipo molto cerimonioso e un po’ furbetto. A Lanteri non piace, ha un non so che di falso… “avrei preferito un altro al suo posto, ma tampì, gli ordini non si discutono” pensa.
Lanteri si mette al comando e prende deciso un invisibile sentiero che porta giù, verso il fondovalle, dove scorre la Bendola.
Pepuccio ha capito tutto e segue in silenzio, Di Francesco continua a far domande: “Ma perché passiamo di qua…? Ma perché andiamo là…?” Lanteri non risponde: “che rompic…,” pensa “si stancherà di parlare!”.
Dopo due ore di cammino nel bosco fitto, tra le pareti di calcare grigio chiaro, appare il torrente, trasparente, con i raggi luminosi che attraversano l’acqua, dai riflessi smeraldini.
I tre seguono per un tratto il torrente, che ad ogni ansa si apre con angoli unici, di una bellezza da lasciare senza fiato.
Il Lanteri sa che poco più giù c’è un laghetto, con una grande roccia levigata, al sole, l’ideale per fare il bagno e distendersi.
Quando sono quasi arrivati, l’orecchio attento del cacciatore distingue, tra il mormorio delle acque, delle voci.
Lanteri fa un cenno di silenzio a Di Francesco e avanza circospetto: il roccione è già occupato!
Tre ragazzi, in mutande, fumano una sigaretta e se la raccontano tranquilli, distesi al sole. Appese ad un carpino, poco più su, tre divise, che non riesce a riconoscere, e tre moschetti: “Cribbio, soldati francesi!”.
Anche i tre bagnanti si sono accorti della presenza estranea, ma talmente forte è la sorpresa, e talmente lontani ormai dal loro ruolo di “difensori in armi del confine”, che rimangono lì, fermi, con la bocca spalancata e la sigaretta penzoloni.
“E adesso? Cosa dobbiamo fare? Saranno entro il loro confine o sono sconfinati nel nostro territorio? Cosa dobbiamo dirgli a questi “quasi nemici” (la guerra non c’è ancora ma … è nell’aria)?”
Le domande che frullano nel cervello sono simili, da una parte e dall’altra, ed i sei restano a squadrarsi, senza sapere bene cosa fare.
Dopo alcuni secondi carichi di tensione, il viso del Lanteri si distende: “Giuanin!” grida.
In uno dei tre francesi ha riconosciuto il cugino Giovanni, di Saorgio che, in servizio negli avamposti francesi della valle Roja, ha avuto la sua stessa idea, e sta godendosi, con due commilitoni, un po’ di sole, dopo aver fatto il bagno nel laghetto.
Le complesse regole d’ingaggio, che sono costate tante riunioni dei Generali dello Stato Maggiore, a Roma come a Parigi, in un attimo sono saltate! Un abbraccio fraterno (In territorio italiano o francese? Bah…, chissà!) e, subito dopo, tutti a fare il bagno.
Era qualche anno che non si vedevano, i due cugini, e di cose da raccontarsi ne avevano. Parlano in brigasco, fitto fitto, ma ogni tanto nel discorso riescono ad entrare anche gli altri due francesi, uno di St.Etienne de Tinee, e l’altro di Barcellonette. Pepuccio capisce qualcosa, ma se ne sta rispettosamente in silenzio, limitandosi ad annuire, compiaciuto, quando si tocca l’argomento “donne”. Di Francesco è nervoso: “non si deve dare confidenza a ‘sti francesi” pensava, bellicosamente: “potrebbe scoppiare la guerra, da un momento all’altro, e questi diventeranno nemici, da abbattere o fare prigionieri!”.
Antonio Lanteri è felice, dopo aver fatto l’ennesimo tuffo nel luminoso laghetto, si distende sul roccione caldo e chiude gli occhi. Sarà l’incontro con il cugino, sarà l’odore inconfondibile e pungente delle erbe di fiume, riaffiorano alla memoria momenti dell’infanzia che pensava dimenticati…
E’ il momento di tornare, si salutano amichevolmente (domani…, di nuovo qui? chissà…) e partono, gli italiani di qua ed i francesi di là. Solo al tramonto quando, dopo tre ore di marcia in salita, Lanteri, Ricca e Di Francesco rientrano al forte di Marta, vengono a conoscenza della grande novità della giornata: l’Italia ha dichiarato guerra alla Francia. E’ guerra!
Lanteri ha un brivido nella schiena. La responsabilità del pattugliamento è la sua, se si sapesse che hanno intercettato tre soldati francesi e non solo non hanno attaccato, ma addirittura hanno fatto il bagno insieme… la Corte Marziale è assicurata!
Incrocia per un attimo lo sguardo del “sivesenco” Pepuccio, sa che non parlerà mai. Cerca Di Francesco, sta confabulando con il Tenente Calzia: “non mi piace ‘sta faccenda” pensa.
La notte dorme agitato, fa sogni confusi, storie bislacche dove entrano ed escono un sacco di personaggi. La tromba suona la sveglia, gli sembra si essersi appena coricato, si alza malvolentieri, se ne starebbe volentieri in branda, ha un brutto presentimento.
Incontra subito il Tenente Calzia, con una faccia strana, serissimo, sembra che lo stia aspettando, in mezzo al corridoio: “Comandi?” fa Lanteri, preoccupato.
“Oggi si va a caccia di francesi!” dice Calzia, in italiano, duro e perentorio: “visto che lei, Caporale Lanteri, è il miglior cacciatore della Compagnia, ci guiderà fino al torrente, e vedremo se saremo così fortunati da trovare qualche nemico che ha avuto la sfrontatezza di sconfinare.”.
Lanteri si sente perso: “quell’infame di Di Francesco ha raccontato tutto, e adesso la Corte Marziale non me la leva neanche il Papa. L’unica speranza è quella che, arrivati al laghetto, non ci sia nessuno, ma se troviamo Giuanin e gli altri, per loro è la fine.”.
Questo ragionamento attraversa il suo cervello con la velocità del lampo, e come dopo il lampo l’oscurità sembra ancora più fitta, così il cervello di Antonio Lanteri piomba nella tenebra più nera.
Avanza sul sentiero come un automa, un senso di nausea fortissimo, e la certezza che, passo dopo passo, si avvicini un dramma inevitabile.
Dietro di lui cammina il Tenente Calzia, e dietro ancora, armati di tutto punto, una decina di soldati: “che cretino sono stato a dar retta a quel serpente di Di Francesco” pensa il Tenente, “adesso sono senza via d’uscita. Speriamo solo che al fiume non ci sia nessuno. Non mi va di sparare a dei ragazzi in mutande, o peggio ancora, sparare a ‘sto disgraziato davanti a me, se tentasse, come temo, di avvertirli per farli scappare. Se almeno non ci fosse la truppa dietro di noi…”.
Antonio Lanteri cammina a testa bassa, con la schiena curva, come se portasse cento chili nello zaino. Ha appena distinto, impercettibili, delle voci provenienti dal basso, l’ultima speranza, che non ci sia nessuno al fiume, è sfumata: “non posso farli beccare così, senza fare niente, li avrei sulla coscienza per tutta la vita, meglio la morte. Chissà come sarà di là, se è come ci raccontava Don Mario…” pensava, stringendo il suo moschetto.
Il rumore metallico del cane della Berretta d’ordinanza del Tenente lo riporta sulla Terra, un brivido freddo gli corre su per la schiena. Sa che quella pistola è per i francesi, ma all’occorrenza potrebbe far fuoco a bruciapelo contro di lui (non sarebbe la prima né l’ultima volta, conosce bene le regole assurde della guerra).
Il tempo è scaduto, tra un paio di minuti saranno sopra i francesi. Antonio, con un groppo alla gola che non lo fa respirare, ha deciso: sparerà un colpo in aria, per dare l’allarme ai francesi e permettere loro di mettersi in salvo.
Sa perfettamente cosa succederà un istante dopo: uno sparo della pistola del Tenente e sarà su un altro sentiero, oltre le montagne…, gli sembra addirittura di vedere già suo padre che gli viene incontro, gli sembra di sentire anche il rumore dei suoi passi…
Il rumore dei passi sì, adesso è più nitido, è quasi una corsa, tra i cespugli di brugo: un cinghiale, testone basso, pelo dritto e occhietto terrorizzato attraversa il sentiero, pochi metri davanti ad Antonio, che meccanicamente preme il grilletto, senza mirare.
Un boato scuote le pareti rocciose della Bendola, seguito immediatamente da un colpo meno forte, più secco, quasi stizzito: la pistola del Tenente ha fatto fuoco!
Lanteri chiude gli occhi: “addio Carlotta!”, li riapre, non è volato via, è ancora lì, circondato dal tenero verde dei larici, si gira lentamente verso il Tenente, che lo guarda negli occhi, ancora più pallido di lui, con la pistola fumante in pugno.
“Il cinghiale” balbetta Lanteri, come a giustificarsi.
“Già, il cinghiale”, annuisce con sollievo il Tenente.
Robertin de Perandré
![468 ad]()



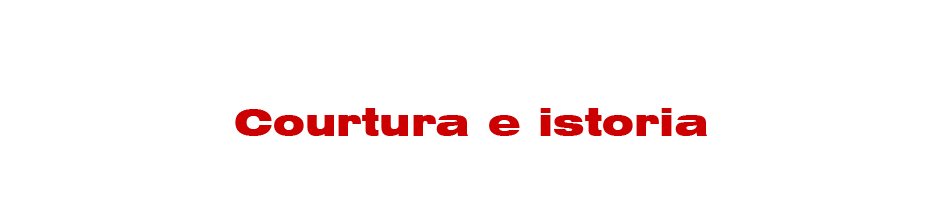







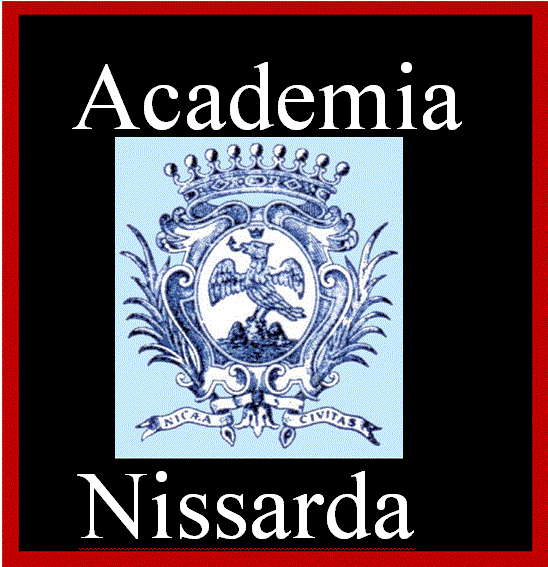













Si vous voulez vous purriez publier le texte
du « PATER NOSTER DE L’ALPAZUR » 35 versions de la priere dans les dialectes des zones de Nice, Cuneo et Imperia dont’on a fait, plusieur année passées la présentation sur « Le Sourgentin » et dans une journé au Séminaire de Nice.
Est possible que quelcun d’entre vous conserve copie du livret publié par le Circolo Ligùstico de Sanremo. Autrement on pourrait vous envoyer le texte scannerizé
Nous voulons bien recevoir ce texte scannerisé. Et si vous nous envoyez les 35 versions du Pater Noster, nous les publierons. Merci.
conte très beau. Bien évidents les rapports très forts qui unissent nos peuples.
Rebaudo