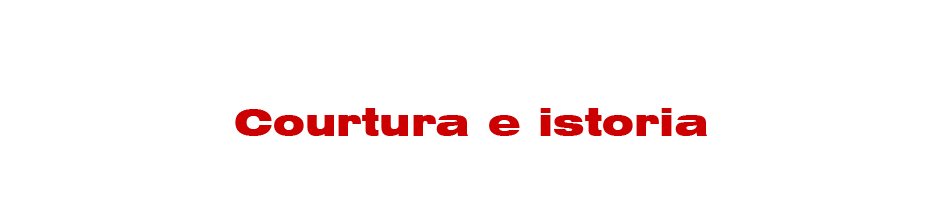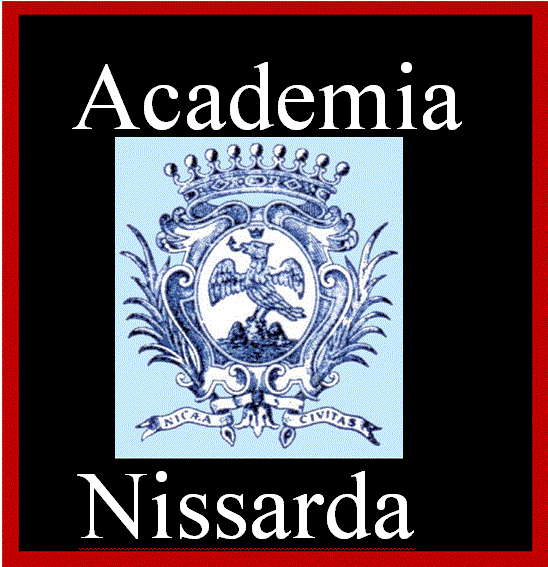Tribulacioun d’un Nissart à Paris – Tribulations d’un Niçois à Paris
Ecrit par Eric FONTAN le 1 déc, 2004 dans la rubrique Textes / Test | 0 commentaires
Vous, qui consultez notre site régulièrement, connaissez notre ami Barbajohan, auteur d’un bon nombre de Contes (Contes de ma Cabane) et aussi de romans policiers (Les cinq yeux de l’abeille, la malédiction des lucioles et Atahut per un vitou) donc l’action se déroule dans notre Pays Niçois.
Il vient de nous livrer une nouvelle bien dans son style non académique qui retrace les pérégrinations d’un Niçois monté à Paris pour y chercher du boulot. Il en trouvera, certes, mais il vivra aussi des aventures pas banales qui orienteront son destin. Au travers de cette nouvelle, Barbajohan, fait ressortir certains traits de caractère du nissart: la solidarité entre « pays », la notion de partage, l’esprit de communauté et la débrouillardise. Je vous laisse à votre lecture…
Tribulacioun d’un Nissart à Paris – Tribulations d’un Niçois à Paris
par Barbajohan.
Après avoir galéré de petits boulots en périodes de chômages après sa sortie du service militaire, Albert Alziari, avait fait comme bon nombre de ses copains de ce gros bourg proche de la côte d’azur. Il avait pris un billet de train, un aller-simple pour la gare de Lyon, espérant trouver du travail en région parisienne. Il en avait, en effet, trouvé assez rapidement, dans ces années 1980, un poste de préparateur de commande chez « De la Commune et Dupont », entreprise de Plomberie Industrielle Préfabriquée. S’étant très vite fait remarquer par son ardeur au travail, sa capacité à prendre des initiatives, et sa bonne humeur, Albert avait obtenu, au bout de deux mois d’activités, la confiance et la satisfaction de ses supérieurs ainsi que la sympathie de ses collègues de travail. Ainsi on lui avait fait comprendre qu’il y avait de fortes probabilités pour que sa mission en intérim se prolonge par un CDI en bonne et due forme.
Cette perspective enchantait Albert, car malgré les trois quart d’heures de transport en commun que nécessitait bi-quotidiennement son travail, un CDI et quelques économies lui permettraient enfin de trouver un studio ou un petit appartement. Enfin, il aurait un chez lui. Car depuis trois mois qu’il était à Paris Albert avait dormi un peu partout chez des copains immigrés dans la capitale comme lui ou dans des squats. La situation était parfois gênante ou inconfortable: il faut dire que la plupart de ses relations habitaient dans des appartements extrêmement petits, dans des quartiers bruyants, populaires et métissés. Sans parler des copains qui en réalité habitaient chez une copine étudiante dont les parents payaient le studio et qu’il fallait évacuer dès que papa ou maman séjournaient à Paris. Voire une piaule qu’un vieux « tonton » amant occasionnel et producteur payait à la jeune comédienne en devenir. Il arrivait que le pauvre Albert fut obligé d’aller passer sa nuit au-delà de la fermeture du bistrot le plus proche, sur le palier, ou réfugié clandestinement dans la salle de bain, le temps que le couple eut épanché ses ébats dans l’unique pièce qui servait de living room.
En attendant, justement une nuit dans un bar, la providence vint au secours du pauvre Albert. Un groupe de consommateurs fit irruption dans l’établissement. Il y avait cinq hommes jeunes plutôt typé ouvriers, en combinaison bleue de meccano, accompagnés d’un autre plus âgé, qui lui était élégamment habillé d’un costume bleu marine et d’une chemise blanche, le tout revêtu d’un loden noir. Une bouille rieuse, une paire de lunettes de vue, et des cheveux grisonnants gominés coiffés en arrière complétait le portrait de l’individu.

– « Allez, assez collé pour ce soir les jeunes, c’est ma tournée. » annonça t il, grand seigneur, avec un accent du sud bien prononcé. Le patron derrière son zinc s’enquit des commandes et le gars s’adressa à Albert – « Et qu’est ce qui prendra le monsieur pour nous accompagner. » – « Vé, si vous m’offrez un verre, ce ne sera pas de refus. Avec plaisir, un demi, alors. Gramaci touplen Monsieur. » – « Oh, tu es d’où toi ? » – « De Nice, pourquoi ? » – « Vé, moi, je suis d’Antibes. Mais Nice, je connais bien, j’avais un commerce, rue Paradis. Le monde, est petit. Et qu’est-ce que tu es venu te perdre à Paris ? » -« Je suis venu pour trouver du travail comme beaucoup d’autres… » – « Et tu en as trouvé au moins ? » – « Que pour sûr et j’en suis bien content » – « Ahi, siès un bouòn pichoun, tu, tiens je te donne ma carte, si des fois tu avais un problème ou que quelqu’un te fasse des misères, n’hésite pas à m’appeler. »
Ce n’est que plusieurs jours plus tard qu’Albert retrouva la carte dans une poche de pantalon. « Roger Bianchini, brocante et antiquité, Achat et Vente, Stand Lou Barbarese, 96 rue Paul Bert 93400 Saint Ouen France. Tel/Fax 01 40 11 54 14.
Les weekends sont long à Paris, surtout lorsque l’on n’a pas d’argent à dépenser en restaurant, théâtre, cabaret ou cinéma. Il y a, bien sûr, les musées et Albert était un passionné: il avait comme cela découvert des coins que même de vieux habitués de Paris ne connaissaient pas… par exemple la buvette du musée Rodin ou celle du Musée de l’Armée aux Invalides. N’aimant pas les touristes, il évitait le Louvre, la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe et le Sacré Cœur. Il adorait aller fouiner le matin avant 10 h au marché aux puces, surtout celui de Montreuil, dont les prix était plus en adéquation avec la réalité de ses rêves et de son porte monnaie. Aussi, il se dit que ce dimanche matin le métro et ses pas pourrait bien le conduire jusqu’à Saint Ouen.
Après, avoir parcouru les étals des vendeurs à la sauvette, sous la voie de chemin de fer, il s’engagea dans les ruelles plus huppées du marché officiel et finit par trouver l’entrepôt magasin « lou Barbarese ». Il surprit Roger Bianchini en grande conversation avec un groupe de « Pieds Nickelés » à la mine patibulaire. – « Bon, l’équipe « où c’est qui qui l’est, l’As de Carreau ? », je veux bien que vous planquiez vos métiers, dans mon arrière cours, mais je n’ai pas envie de voir débouler la maison poulaga dans mes rayons. Alors c’est la dernière fois que je vous le dis, je ne veux pas voir vos gueules devant ou à l’intérieur de mon commerce. C’est compris. » Au hochement de tête du groupe, Albert compris que les décisions de Monsieur Roger étaient sans appel et qu’il devait avoir les moyens de se faire respecter. Le groupe s’esquiva par une porte dérobée, encombrée par l’entassement des meubles et objets divers à l’arrière de la boutique. Puis il se retourna et aperçu Albert : « Monsieur, est intéressé par quelque chose en particulier ? » – « Vous me reconnaissez pas, vous m’avez donné votre carte l’autre jour. Je suis Albert le nissart. » – « Ah es ver, bien entre mon garçon, aloura, couma va ? » – « En gamba, ma la mar e li mieu mountanha me mancan, ièu ai la zounzouneta à Paris. » – « Va te capissi ben pitchoun, et dans quel quartier tu crèches ? » – « Ben, un peu partout, quelques jours chez l’un, quelques jours chez l’autre, mais maintenant que j’ai du boulot dans quelques temps, je pourrais me trouver une piaule à moi. » – « Ben, vé, tu fais bien de m’en parler, j’aurai peut-être une combine qui t’arrangerais un temps. Écoutes tous les mercredi soir je suis à la permanence de Patrick Stéfanini que j’ai aidé avec Jacquou lors de sa campagne à Nice, c’est un grand ami du maire de Paris, Jacques Chirac. Passes me voir vers 18h30. J’y serais. C’est à Montmartre. Je te griffonne l’adresse sur une carte du magasin. »
Et le mercredi qui suivit, Albert à 18h30 tapante, se retrouva devant une boutique dont la vitrine était recouverte d’affiche à la gloire du RPR et de Jacques Chirac. C’était la première fois de sa vie qu’il poussait la porte de la permanence électorale d’un parti politique. Quelques solliciteurs, femmes et hommes plutôt âgés portant des vêtements endimanchés ou endeuillés attendaient sagement alignés sur des sièges contre un mur gris. Les locaux étaient modestes, une table qui devait servir de bureau et au fond, une autre pièce dont s’échappait quelques murmures de discussions. Un jeune homme en tenue de VRP multicarte, un sourire forcé de larbin, sorti du bureau et vint à sa rencontre. – « Bonjour, monsieur, vous aviez rendez-vous ? » – « Oui, avec Monsieur, Roger Bianchini. » – « Ah ! Il est en rendez-vous avec Monsieur Stéfanini, je vais voir si je peux le déranger, et lui faire part de votre présence. C’est de la part ? » – « Albert le Niçois. » Le gars parut à la fois surpris et inquiet et Albert se dit : « Manquerait plus qu’ils me prennent pour Spaggiari » Et c’est peut-être ce qui se passa car très rapidement cinq personnes sortirent du bureau et se mirent à le dévisager d’un air bizarre dans un silence absolu. Enfin, la porte extérieure de la permanence s’ouvrit faisant sursauter l’assemblée, et Monsieur Roger apparu. Il fit un signe aux membres du bureau et se tourna vers Albert : « Je suis un peu en retard, même avec mon macaron officiel, j’ai du mal à me garer. Bon, je dis bonjours à mes amis et on ira boire un coup en face pour parler. » Ce fut une séance de baïetas et de main dans le dos, d’exclamation et de grands sourires entre Monsieur Roger et les personnalités qui étaient sorties du bureau pour voir qui était Albert le Niçois.
Enfin, Albert suivit Roger, ils traversèrent la rue, firent quelques pas et rentrèrent dans un bar. Roger fit un petit signe de reconnaissance au patron, et ils prirent place à une table. Le patron s’enquit des commandes : – Une mauresque pour moi, dit Roger. – Parié ! répondit Albert. – Avec une tranche de citron, Monsieur, le Perrier ? Roger s’esclaffa de rire : « Mais non, il a dit parié, cela veut dire la même chose ! »
Sur ce, une apparition traversa l’établissement. On n’était qu’au début de l’hiver et pourtant la créature semblait, par son accoutrement, sortie d’un goulag sibérien. Il était habillé de plusieurs couches de vêtement, un pantalon de lainage noir dont un trou le long de la cuisse laissait apparaitre un autre pantalon de velours marronnasse aux côtes usées. Il portait une veste de laine à bouton, surmontée d’un gilet bleu, le tout couvert d’une autre veste de lainage gris, et recouvert enfin d’une vielle capote militaire dont les galons pendaient par un fil, et qui avait dû faire la campagne de Russie avec l’armée Roumaine. Comme couvre-chef un chapeau feutre sans plus aucune forme, sous lequel dépassait un bonnet, enfin des mitaines vertes « feldgrau » sur lesquelles des générations de mites avaient dû se succéder pour copuler joyeusement.

Roger l’interpella : « Monsieur Maurice, venez que je vous offre quelque chose » L’homme se retourna et exhibât un sourire de satisfaction, un quart des stocks d’Or de la Fédéral Réserve des USA devaient être dans sa bouche. Le temps que l’homme les rejoignit, Roger murmura à Albert : « Il ne paye pas de mine, on dirait Archimède le Clochard, mais Monsieur Maurice est un des hommes les plus riche de Paris, un des plus puissant aussi…. » L’homme prit un siège et s’assit à côté d’Albert, qui sentit aussitôt comme une odeur de papier brulé mélangé à une odeur de charcuterie rance. Après quelques échanges de civilités, Monsieur Maurice cria d’une voix enrouée et nasillarde : « Patron, un Clacquesin chaud pour moi, ça me réchauffera. »Roger passa aux choses sérieuses : « Cher Monsieur Maurice, mon ami Albert, ici présent cherche pour quelques mois une habitation provisoire avec un loyer le plus petit possible, car il vient tout juste de commencer à travailler. Vous n’auriez pas une combine par hasard ? » Monsieur Maurice dévisagea longuement Albert, en dodelinant de la tête. Il se mit à réfléchir, se gratta la joue, mit un doigt dans son nez, le tourna, le ressorti, l’examina, fit une moue interrogative et enfin s’exprima. – « Cela se pourrait bien, en effet » Puis il avala une gorgée de Clacquesin. Et se mit à regarder le plafond d’un air inspiré. Quelques minutes passèrent. – « J’aurais peut-être quelque chose du côté du vingtième. Un chantier à garder la nuit et les weekends. En fait, il n’y a qu’un grand trou à garder, une opération immobilière provisoirement suspendue en raison de recours juridiques. Mais il est important de faire croire que le chantier continue à être surveillé pour justifier les frais que je ne manquerai pas de réclamer à la partie adverse quand, en appel, je gagnerai ce procès. » – « Et il y a de quoi se loger sur ce chantier ? » demanda Roger. – « Oui, il reste un bungalow de chantier, avec tout le confort, l’électricité, un point d’eau, le chauffage et même le téléphone. D’ailleurs s’il sonne, vous n’aurez qu’à décrocher et dire : Adressez-vous à maître Perez. » – Et le lieu serait accessible quand ? Repris Roger. – « Si vous avez un crayon et un bout de papier, je vous marque l’adresse. Je téléphonerai demain matin au concierge du 48 qui est en face du chantier et il vous donnera les clefs. » – « Je vous remercie beaucoup. » dit Albert à l’attention de Monsieur Maurice. – « Remerciez, Roger, mais ne me remerciez pas, chaque fois que quelqu’un m’a dit merci, c’est que ça me coutait quelques chose. » Puis ils se séparèrent…..En cheminant dans la rue, Roger dit : – « Si je peux te rapprocher, tu dors dans quel quartier en ce moment ? » – « Si,vous passez pas très loin de la Place de la république ou du Boulevard Voltaire, ça peut me rapprocher. »– « République, c’est bon, ça ne me fait pas un grand détour. » Une fois installé dans la Mercédès, la conversation repris, le long du trajet – « Comment pourrais-je vous remercier, Monsieur Roger. » – « Mais, rendre service est un plaisir, tu ne me dois rien. Toutefois si tu voulais me faire plaisir, il te suffira de prendre la carte de notre parti, et de te rendre disponible pour faire de la figuration dans quelques réunions. Cela dit à chaque fois, le buffet est excellent….L’important dans ce milieu, c’est surtout de ne jamais parler de politique, tu dis bonjour, tu souris souvent, et tu te fais plein de copains. Un conseil toutefois, ne cherche pas à séduire une femme chez ces gens, c’est facile parce qu’ils sont toujours trop occupés et qu’elles s’ennuient, mais c’est une source d’embrouille. » – « Au fait, vous disiez que Monsieur Maurice était un des hommes les plus riche de Paris, pourtant il s’habille comme un clodo. » – « Riche, mais d’une radinerie digne du livre des records, tu sais pourquoi, il est toujours aussi couvert ? Et bien je vais te le dire, pour échapper aux impôts,et justifier d’un minimum de revenu légal ; il s’est déclaré comme gardien d’une de ses nombreuses sociétés écrans, et pour échapper à toutes taxes sur le patrimoine et ne pas payer de loyer, il vit dans les locaux. » – « Et alors ? » – « Cette société, loue des chambres froides, stockage de surgelés…… »
Quelques jours plus tard Albert, se présentait au 48 Passage Hébrard dans le vingtième, le quartier semblait plutôt déglingué avec des appartements murés, des halls d’entrées qui débouchaient sur des courées noires et décrépites, des camionnettes garées en doubles files d’où des tâcherons déballaient des cartons ou des ballots sur des diables que des « coolies » s’empressaient d’enfourner dans des entrées d’immeubles. On aurait dit que toute la planète s’était donné rendez-vous dans ce secteurs de Paris: l’Asie, l’Orient, l’Afrique, et quelques ilots Bourguignons et Auvergnats dont les façades des commerce s’effaçaient déjà sous le vent de l’histoire. La grosse porte était fermée, mais il trouva une sonnette ou il était indiqué : Maurer Concierge. Il sonna et le bruit prolongé de la gâche électrique lui indiqua qu’il pouvait entrer. Il poussa la porte et se retrouva dans un couloir crasseux avec un grand escalier en bois et au fond de ce couloir une porte aux carreaux cassé d’où parvenait la lumière d’une cour intérieure. Il entendit le bruit d’un jeu de verrous et une porte s’ouvrit sous l’escalier, un homme grand, maigre et élancé apparu vêtu d’une combinaison de saut dite peau de saucisson et coiffé d’un bonnet amarante.

– « Vous cherchez qui ? » – « Monsieur Maurer, le concierge, je viens de la part de Monsieur Maurice. » – « Adjudant-Chef, Maurer, faisant fonction de gardien d’immeuble et de concierge. Mais venez donnez-vous la peine d’entrer dans ma cagna. » Albert suivit donc l’adjudant-chef Maurer dans sa loge. La pièce était quelconque, carrée, la lumière d’un vieux néon qui avait dû servir de piste d’atterrissage à de nombreuses escadrilles de mouches éclairait péniblement le décor. Décor constitué d’un vieux vaisselier, en deux parties sur lequel trônait une série de portrait. Au mur le portrait d’un parachutiste entouré de certificats militaires et de décoration, le reste des bibelots étaient Asiatiques ou Arabes. Une table, sur laquelle trainait un verre couleur vinasse, un napperon en dentelle qui avait dû être blanc, et une assiette comportant encore quelques reliefs de repas. Un fauteuil recouvert de plusieurs couches de vieilles couvertures écharpées et sur lequel se prélassait au milieu des poils voletants une tribu de chats. – « Prenez une chaise, Monsieur, et asseyez-vous. Non, pas celle-là, l’autre, celle-là les chats on tellement fait leur griffes sur les pieds que j’ai peur quelle ne casse. » Albert finit, par trouver une chaise dont les pieds était intact comparativement au paillage du dossier qui, lui, avait servi d’affutoir de griffes aux fauves. – Je viens chercher les clefs du chantier en face, je suis le nouveau gardien. – Enfin, un autre poste, je n’arrivais plus à tenir la position, il y en avait toujours qui cherchaient à squatter ou qui balançaient leur sacs poubelles par-dessus la balustrade. Je suis content que ce soit un jeune homme blanc qui ait eu le boulot, je craignais le pire. Je vous fais un petit « kawa », allez, pour marquer notre rencontre. Albert ne se sentait pas de refuser, malgré son appréhension sur l’état de propreté des ustensiles qui allaient servir à faire le café et à le servir. – Volontiers, Monsieur Maurer…. – Ici, c’est soit Adjudant-Chef Maurer, et l’on répond « Volontiers mon adjudant-chef », soit, comme nous allons être voisin et qu’en plus vous êtes civil, vous pouvez m’appeler Gérard. – Et bien merci pour le café, Gérard.

– A la bonne heure, je vous laisse quelques instants, je passe à la popote pour préparer le jus. Le temps que le café se fasse, Albert Alziari, laissa trainer son regard sur les portraits et les photos. Il y avait la photo d’un jeune para français qui tenait dans ses bras une ravissante Vietnamienne en tenue blanche de mariée. Une photo du même jeune para décoré par un officier supérieur en képi. Des photos d’enfants Vietnamiens, et d’un autre jeune homme lui aussi aux yeux légèrement bridés en uniforme de Gendarme. Au milieu une photo vraisemblablement plus récente de Gérard en costume civil à côté de Jean Marie Le Pen. En symétrique une autre série de photos et de portait, le même Gérard Para un peu plus adulte en tenue Léopard, casquette Bigeard en arrière dans un paysage de montagne méditerranéen, puis un Gérard en grande tenue militaire pourvu de sa fourragère, de trois décorations et d’une jeune femme plutôt de type oriental à la sortie d’une mairie entouré d’une haie d’honneur de militaires formant une voute à l’aide de leur sabre, enfin d’autres enfants, filles et garçons, et un jeune adulte en tenue de pilote d’hélico qui avait quelque trait de ressemblance avec le jeune para.

Le bruit caractéristique du café passant indiqua à Albert que son hôte ne tarderait pas à réapparaitre. Effectivement quelques minutes après, Gérard porteur d’un grand plateau rond en cuivre ciselé était de retour, il déposa deux tasses immaculées sur deux soucoupes en argent, et un sucrier de même facture sur la table. – En « indo », j’ai souffert, les « Viets » ne buvaient que du thé et jamais de café, et il n’était pas évident de se faire ravitailler dans les postes isolés comme le mien. Heureusement, il y avait un commerçant chinois qui avait compris la combine, je n’ai jamais su comment il faisait pour passer les « Check point Viets », ni notre champ de mine, mais toujours est-il qu’il se présentait une fois par semaine à la porte du camp avec ses cinq paquets de café. – Vous avez fait la guerre d’Indochine Gérard ? – Engagé volontaire en 49, dix-sept ans à la sortie des maquis, fin de la campagne d’Allemagne, occupation en Autriche, le Paradis. Quand j’ai été démobilisé, je n’avais plus envie de subir un patron, la famille, et voir mon avenir bouché par le mur qui entourait l’usine. Alors l’Indo, ça avait de nouveau le gout de l’aventure et du barouf.

Et après l’Algérie. Vingt Sept Ans sous l’uniforme à servir la France; mais vous avez dû voir les photos ? – Oui, en effet, j’ai aperçu quelques portraits. – Je vais vous raconter, dit Gérard en se levant. À ce moment-là, on frappa à la porte, et Gérard s’en alla ouvrir. – Ah, c’est toi, Mustapha, mon petit, qu’est-ce tu veux ? Le Mouton pour ta grand-mère, reste là je vais le chercher au « congélo ». Gérard, traversa la pièce et se dirigea vers la cuisine. Il revint avec in gros paquet emballé dans un morceau de toile et retourna à la porte d’entrée. – Voilà « li moutun pour ta djetah ». Oui, je monterais demain soir manger le couscous avec vous. Tu remercieras ta « djetah » et tes parents. Puis Gérard revint : « Où en était on ? » – A l’indo. – A oui l’Indo, un pays merveilleux, des combattants remarquables de courage et de bravoure. Quel gâchis, mais quelle aventure, quelle épopée. Ils étaient chez eux, ils défendaient leur pays, leur culture, c’est nous avec nos conneries de vouloir à tout prix en faire des Gaulois qui les avons poussés dans les bras des cocos. Attendez ! Il se leva et ramena du buffet une photo sous cadre de verre. – Vous voyez là c’est moi, le jour de mon mariage avec « Hoàng Mai » ce qui veut dire fleur d’abricotier jaune,

elle était belle, n’est-ce pas ? Elle était tellement menue et gracieuse que lorsque nous avons évacué, je l’ai planqué dans mon sac en montant sur le bateau. Heureusement, je suis tombé sur un officier de marine, qui avait fait la même chose, il a trouvé une cabine sur le Pasteur et on n’y a planqué nos femmes. Sur la porte, il avait collé une affiche : Attention malades contagieux. A la fin de la traversée, arrivé à Marseille, il y avait huit femmes et deux enfants dans la cabine. La combine avait dû filtrer. J’ai eu deux enfants avec « Hoàng Mai », Sophie et Henri. Sophie est devenue médecin et Henri officier de Gendarmerie. – Et votre femme ? – Hélas, quand on est revenu, j’ai été muté en Allemagne, après sa deuxième grossesse, elle s’est mise à déprimer, le mal du pays, ça lui a été fatal. Ce sont mes parents qui ont élevé les gosses, moi je ne les voyais qu’en perm’. – Et l’Algérie ? – Ah, l’Algérie, c’était autre choses, c’était pratiquement la France, enfin une France Méditerranéenne dans les villes avec des Italiens, des Espagnols, des Maltais, des Juifs et des français venu de toute part, des Alsaciens, des Lorrains comme moi. Dans le Djebel en Kabylie, ce n’était pas la même chose, ce n’était pas des Arabes, ça aussi les gouvernements français ne l’on pas compris. Mais nos généraux étaient traumatisés d’avoir perdu la bataille face aux « Viets », il ne voulait pas la perdre face aux Arabes.

On a réussi à faire des Kabyles nos ennemis alors que durant des siècles, ils avaient résisté à tous les envahisseurs y compris à ces mêmes Arabes. C’est de Gaulle qui a donné les clefs de la maison au FLN qui eux étaient planqués en Tunisie ou au Caire. Enfin, au milieu de cette merde, de ce sang et des trahisons, j’ai rencontré l’amour et j’ai refait ma vie. Il se releva à nouveau et revint avec une autre photo. – Vous voyez, là c’est moi et « Aïcha », le jour de notre mariage, j’ai eu du mal à obtenir les papiers et il a fallu menacer le maire du village avec nos flingues pour qu’il accepte de nous marier… même chez les pieds noirs, qu’un sous-officier français d’autant plus un para, épouse une indigène c’était mal vu. « Aicha » c’était son nom enregistré par les affaires indigènes pour qui tous les indigènes en Algérie devaient être arabo-musulman, mais son vrai prénom dans son village c’était « Awrigha » : la dorée, l’ensoleillée.

Son frère était chez les Fells, on a conclu une trêve entre combattants et il est venu au mariage. Il m’a dit : Surtout ne l’abandonne pas, amène là avec toi, ce qu’ils feront aux nôtres sera terrible. Il avait compris. Sa sœur s’étant marié à un roumi, ça s’est su et il a été torturé et achevé par ses propres compagnons de maquis sur ordre d’un commissaire politique venu de Tunis. J’ai tenu parole et j’ai ramené « Awrigha » en France grâce à, paradoxe, une famille plutôt OAS d’Oran. Car évidemment j’avais rejoint le camp de la sédition. Hélas ma femme est décédée, il y a huit ans. Mais nous avons réussi notre vie, elle s’est occupée comme une vraie mère de mes premiers enfants et nous en avons encore fait trois autres. Il y en a un dont je suis d’ailleurs très fier c’est Antalas, plus jeune breveté pilote d’hélico de combat de l’armée française. Vous avez dû voir la photo. À nouveau le récit des souvenirs de l’Adjudant-Chef Gérard Maurer fut interrompu par quelqu’un qui frappa à nouveau à la porte. – C’est cela, la servitude du concierge, excusez-moi. Et il se leva ouvrir la porte. – Ah, c’est toi, Sarakolé, qu’est-ce qu’il y a encore ? Les papiers pour la « sicuriti souciale » ? Tu m’as bien amené tous les papiers que je t’avais demandé ? Bon, ben laisse-moi tout ça, je vais m’occuper de te remplir les formulaires, repasse demain après le travail. Gérard Maurer, revint et posa une liasse de papier sur la table. – Je peux vous poser une question ? – Bien sûr – Vous n’ouvrez jamais les volets de votre appartement ? – Jamais, quand je le faisais, il y en a qui me cassait les vitre en me jetant des cailloux, une façon de vous obliger à partir pour coloniser les immeubles. Les Chinetoques descendent de Belleville, les Africains poussent à l’ouest, les Kurdes virent les Arabes, et les Kabyles virent les Algériens. Sans parler des derniers arrivants qui cherchent à s’incruster. Et il ne faut pas vous leurrer, si on laisse le parc immobilier et le quartier se détériorer c’est pour virer les derniers petits blancs propriétaires, dans quelques temps vous verrez comme plus bas, ils transformeront les derniers ateliers en lofts de luxes pour jeunes bourgeois socialos. Et nous, il nous mettrons dans des ghettos de banlieue au milieu des hordes barbares de clandestins, jusqu’à ce que crevant de faim ils nous bouffent. Parce que les Bamboulas et les Muslims qui arrivent ce n’est pas des braves bougres comme la famille de Mustafa ou de Sarakolé, ils rêvent de remplacer la république par la Sharia. Alors si je vis les volets fermés, c’est que je les connais les Niakés, les Fells, et les Bamboulas, et les autres enturbannés quand ils passent devant ma position, ils repèrent les lieux, pour mieux attaquer. Tant qu’ils ne sauront pas combien j’ai de vivre et de munitions, ils n’oseront pas. D’ailleurs quand vous serez installé en face, soyez prudent, prenez-vos précautions. Vous avez une arme au moins ? – C’est-à-dire que j’ai récupéré, un vieux 8mm 92 aux puces à Montreuil, une fois nettoyé, il devrait encore pouvoir tirer si je trouve des cartouches. – Ah, le Revolver d’Ordonnance de la MAS, j’en avais un en Indo, mais je l’ai échangé avec une gourmette en Or avec un Colt 45 US. Ces pignoufs de ricains qui se foutaient de notre gueule quand on pataugeait dans les rizières. Ils ont bien prit la pâtée quand ils y sont allés à leur tour malgré des moyens qui était de cent fois supérieurs aux nôtres. Je l’ai gardé celui-là parce qu’il y a gravé dessus Propriety of US Gouvernement, ça leur fait les pieds à cette bande de dégénérés qui veut gouverner le monde. Je vais regarder dans mes fonds de tiroir, il doit bien me rester quelques poignées de munitions de 8mm 92. Albert Alziari, ne put refuser plusieurs tournées d’anisettes, enfin Gérard Maurer lui remit un trousseau de clefs. – Alors, la grosse clef en acier de sécurité c’est celle du portail, celle un peu plus petite c’est celle de la porte la plus petite, la porte en acier à côté du portail. Les deux jaunes plates, ce sont celle des cadenas des chaînes qui renforcent la fermeture du portail. Les deux petites blanches, ce sont celles du bungalow, l’autre jaune c’est celle du coffret de chantier pour enclencher le disjoncteur principal pour avoir le courant dans le bungalow. Dans le bungalow une fois ouvert, il y a une autre boite à clefs, tout est indiqué, il y a la clef de la cabine des chiottes qui est à côté du bungalow et la clef de la boite à vanne pour avoir l’eau dans le lavabo du bungalow et dans les chiottes. Par contre, il n’y a qu’un réchaud électrique sur une table, un banc, deux chaises et un lit de camps, comme meuble. Vous comptez dormir ce soir ? – Non, je reviendrais Samedi pour m’installer, j’aurais la journée et le Dimanche pour parfaire mon installation. – Bien, ben, bonne installation, alors. Quand vous serez confortablement installé dans vos quartiers, repassez-me voir, je vous ferais un porc de lait à la Vietnamienne .

Finalement, Albert Alziari, avait organisé sa petite vie dans son Algéco ; le quartier n’était pas aussi terrible qu’à première vue, les gens dans leur grande majorité étaient plutôt solidaires, serviables et généreux. Un peu comme s’ils avaient compris que dans ce petit monde qui allait disparaître, se tenir les coudes, se respecter malgré les différences, constituait une ultime action de résistance, une sorte de combat d’arrière-garde, qui retardait l’échéance. Quand il rentrait chez-lui, le soir, le long de la rue, il passait devant plusieurs boutiques, celle du Chinois, celle du Congolais, celle du Tunisien, celle du Turc qui en réalité était un Kurde au vu du drapeau qui ornait le mur du fond. Il y rentrait parfois pour acheter une bricole, mais surtout pour dire bonsoir ; il n’était point rare qu’il n’en ressorte avec un cadeau, une soupe chinoise, des fruits exotiques, une part d’un plat typique du pays du propriétaire des lieux. Il avait même trouvé une vieille mamie, blanchisseuse chinoise de Saigon pour s’occuper de son linge à un prix défiant toute concurrence. Jamais, il n’avait ressenti un quelconque sentiment d’insécurité, personne n’avait tenté de le cambrioler, ni de pénétrer sur le chantier. Oh, bien, sur, tous les habitants du quartier n’étaient pas des saints, mais selon le vieux principe des voyous : « Tu ne chie pas dans l’endroit où tu dors, où celui où tu manges. » ; ils allaient « bosser » ailleurs. Certains dans le quartier, faisaient une chasse discrète mais efficace aux junkies et aux dealers, non pas au nom de la morale, mais seulement pour ne pas attirer les flics sur certains commerces d’arrière boutiques. Grâce, à Monsieur Roger, le bungalow avait été rapidement et gratuitement aménagé avec de luxueux meubles d’époque. Albert s’étant interrogé sur la qualité et la valeur du mobilier qui était mis à sa disposition, Roger lui répondit : « Au contraire, c’est toi qui me rends service. Tu sais parfois on m’amène des meubles pas très clairs dans des lots que j’achète. Je préfère qu’ils se refassent un certificat de virginité chez-toi. D’ailleurs si dans tes relations, tu trouves des clients particuliers intéressé par une pièce, aucun problème, on fixe le prix en dessous duquel tu ne cèdes pas et tu te prends une commission commerciale de 15% en liquide. Tu n’as qu’as dire que ce sont des meubles que tu as obtenu par héritage, mais surtout que du liquide, pas de chèques. Je vais te donner la méthode, tu fais quelques polaroïds. Tu mets ça dans ton portefeuille et dès que tu entends quelqu’un parler de brocante, d’antiquité, ou de maison de campagne à Barbizon ou en Normandie, tu sors tes photos en jouant au « niocou« , du style : j’y connais rien, mais vous peut-être….. » Il est vrai que le mélange des styles, Henri IV, Louis XV, Napoléonien et Louis Philipart n’était pas forcément révélateur, de bon goût et surtout fonctionnel. Sans parler des portraits et des diverses sculptures antiques néoromantiques, avoir en lointains ancêtres une galerie de maréchaux de France et quelques marquises emperruquées lui apportait par procuration une certaine légitimité. Toutefois c’était un Algéco-double tout en long, pourvu de larges fenêtres coulissante pourvue de stores, une pièce cloisonnée à une extrémité qui servait de chambre, une grande pièce qui avait dû servir pour les réunions de chantier ou de réfectoire et à l’autre bout une autre pièce cloisonnée qui devait servir de cuisine et de lavabo. En parlant de fonctionnel, il n’y avait qu’un robinet d’eau froide donnant sur un grand évier en inox. Pour se laver, il fallait faire chauffer de l’eau dans une grande gamelle sur l’unique plaque chauffante et utiliser une bassine. Roger, ne devait pas disposer dans ses réserves d’une cabine de douche médiévale. Quant aux autres commodités hygiéniques, il fallait ressortir du bungalow, marcher environ une vingtaine de mètres dans la boue pour avoir accès à une étroite cabine, sans chauffage et pas isolée pourvue d’un WC dit à la Turque, dont la chasse était constitué d’un simple tuyau flexible au bout duquel quelqu’un avait installé un robinet sans doute, vu son état, récupéré sur le chantier de démolition. Le lit sur lequel dormait Albert était soit disant un authentique lit Louis XIII venant d’un relais de chasse de sa majesté ; il n’avait pas été possible de monter le baldaquin à cause de la hauteur de plafond, mais Albert en avait trouvé une utilisation, il l’avait transformé en penderie. Le matelas étant absent, Albert était allé chercher un bout de mousse épais coupé sur mesure au BHV qu’il avait ramené en métro. En ce qui concerne les draps et les couvertures, mamie Saigon, l’avait envoyé chez un sien cousin qui tenait une chaine de pressing blanchisserie, il fut ravi de lui céder pour un vil prix des draps et couvertures laissées par des clients qui n’étaient jamais venu les réclamer. En cadeau, il eut droit à une dizaine de pantalons, une douzaine de chemises, six pulls et trois vestes. Ainsi, allait la vie, dans le « Casteu Alziari », en plein milieu du vingtième arrondissement de Paris. Et l’hiver, arriva, celui de janvier, où même à Paris, il gèle…..Et la première chose qui évidement gela fut le tuyau d’alimentation en eau des toilettes. Albert trouva une solution provisoire, pisser dans une grosse boite de conserve, vieux truc appris en bivouac sous-igloo dans les chasseurs alpins, qu’il suffisait de vider le lendemain matin dans le terrassement du chantier. Pour un exercice plus délicat, il récupéra un seau qu’il pourvoyait d’un sac poubelle en plastique, une fois la chose faite, il fermait soigneusement le sac et s’en débarrassait dans le premier conteneur à ordure qu’il trouvait en sortant de chez lui avec ses autres déchets. Cette méthode avait sont avantage, celle de ne pas se refroidir en sortant de l’algéco qui lui était bien chauffé.
Mais voilà qu’un matin, il emballa son sac dans une magnifique boite en carton vide de pâtisserie tunisienne des « Délices de Carthage », un cadeau que le tunisien lui avait offert pour son anniversaire et qu’il avait conservée tant la boite était gracieuse. Il prit même le temps de réajuster les rubans. Puis il sorti dans la rue, son paquet a la main, il fit quelques pas en descendant et s’aperçut que son conteneur habituel n’était pas à son emplacement devant le 41 du passage Hébrard. Pas de problème en face au N° 44, il y avait un conteneur. Il traversa entre deux voitures et à ce moment-là il perçu un grand bruit de freinage et se retrouva par terre. Le conducteur du véhicule descendit immédiatement et se précipita sur Albert. – Mon dieu, mon dieu, je ne vous ai pas vu à temps. Ne bougez pas je vais prévenir immédiatement les secours, j’ai un téléphone dans ma voiture. – Je n’ai rien, Monsieur, vous ne m’avez même pas heurté. J’ai eu peur et j’ai glissé dit Albert en se relevant. – « Mais, je vous connais, dit le conducteur, vous travaillez chez « De la Commune et Dupont » à la préparation des expéditions. » – Oui, tout à fait, j’allais d’ailleurs prendre mon métro pour aller travailler. – C’est vraiment un hasard, je ne passe jamais par cette rue, c’est vraiment le destin. Vous ne me reconnaissez pas ? Je suis André Louis de la Braconnière, le directeur commercial de « De la Commune et Dupont » ? – J’avais entendu parler de vous et je vous ai peut-être aperçu, mais excusez-moi je ne vous avais pas reconnu. – Ne vous excusez-pas, c’est moi qui devrait m’excuser, j’aurai pu vous blesser gravement, voire vous tuer. – Je suis aussi coupable, Monsieur, j’ai soudain traversé entre deux voitures sans faire attention. Mais je vous rassure, je n’ai rien. – Voulez-vous vous en assurer ? Je peux vous conduire aux urgences dans un hôpital ou mieux dans la clinique d’un ami. – Je vous remercie, monsieur, mais je vous jure, tout va bien. Mais il va falloir que j’y aille, j’ai dû manquer la correspondance et j’ai peur d’être en retard. – Je ne vous laisse pas repartir comme cela, de toute façon, moi aussi j’allais travailler. Alors vous montez à côté de moi. Si nous avons un léger retard ne vous faites pas soucis, j’arrangerai ça avec Monsieur Lautron votre supérieur. Ainsi, Albert se retrouva assit à côté d’André Louis de la Braconnière, dans sa superbe Audi 80.

Au bout de quelques feux rouges, André Louis s’adressa à son passager. – Pourrais-je vous demander toutefois de rester discret sur cet incident et le lieu de notre rencontre. – Aucun problème, Monsieur, je n’en ferai part à personne. – Mais, je remarque que vous êtes toujours cramponné à votre paquet ; il n’y avait rien de précieux et de fragile dedans j’espère ? – Absolument pas, Monsieur, c’est juste mon casse-croute pour la pause de midi… Après tout Albert se dit qu’il trouverait bien un moment pour se débarrasser de cet encombrant et compromettant paquet dans une des poubelles de l’atelier. Arrivé sur la bretelle du « périf », le combiné téléphonique de la voiture sonna et André Louis décrocha : – « Oui, je suis parti sans te réveiller mon amour, je sais……je te raconterai. J’ai failli avoir un accident. Il faut que je raccroche, je conduis et j’ai un passager. Comment je n’ose pas le dire ? Oui, bien sûr, je t’aime et tu me manque. Voilà tu vois, je l’ai dit, bisou, bisou, bisou, aller, je raccroche…. » Albert faisait celui qui essayait d’être discrètement invisible ….. Arrivé à l’entrée de la zone industrielle ou se trouvait l’entreprise « De la Commune et Dupont », le téléphone sonna à nouveau et le chauffeur se rabattit sur la droite et décrocha. – « Non, finalement, j’étais épuisé à la sortie de ce séminaire, ma chérie, j’ai préféré ne pas prolonger ma conduite de nuit et je me suis arrêté dans un formule un. Je me suis réveillé un peu trop tard et j’arrive à peine au travail. Oui, bien, sûr, je serais ce soir à la maison, ma chérie. Je t’embrasse et je raccroche. J’ai un passager et il est gêné d’entendre notre conversation. Oui, bien sûr tu m’as manquée tout cet interminable weekend. Bisou, bisou. » Et il raccrocha. Albert compris alors qu’il ne s’agissait pas de la même personne et les raisons pour lesquelles il fallait qu’il restât discret.
Albert et André Louis prirent le même ascenseur, mais Monsieur le Directeur Commercial, ne descendis pas lui au troisième étage et continua son ascension jusqu’aux étages supérieurs du siège de l’entreprise. Arrivé dans l’open space qui regroupait les sous-administratifs productifs, Albert se précipita vers son bureau. Une silhouette vint vers lui et il croisa le regard sévère de Monsieur Lautron, qui lui montra l’horloge et lui glissa discrètement : « Dommage, vous nous aviez jusqu’à présent donné plutôt satisfaction, il est évident que de tels retards répétés nous amèneraient à reconsidérer votre avenir dans notre société. » Albert, accusa la sentence sans rien dire, il avait compris que Monsieur Lautron, superviseur général ne l’aimait pas. Il posa son paquet dans un coin de son bureau, et se mit immédiatement au travail sur son clavier d’ordinateur, il saisit quelques bordereaux, répondit à deux coup de téléphone et téléphona lui-même au chef d’atelier pour s’assurer du suivi d’un complément de commande. Il lui sembla alors qu’un fumet révélateur sous l’effet de la chaleur qui régnait dans les bureaux s’échappait du maudit paquet. Il eut alors une idée ; il remarqua que Lautron était fort occupé au téléphone. Aussi, il en profita pour se lever, il alla jusqu’au local machine à café, réfectoire ou salle de réunion de l’étage qui disposait d’un frigo et il y rangea son paquet. Le froid allait faire son œuvre et geler les risques d’odeurs. Il le récupérerait au moment opportun, à la pose de 13h par exemple. Mais à 12h 45, il fut appelé au quai des expéditions pour régler un problème de livraison, il fallut trouver aux ateliers des fournitures de raccords supplémentaires et lorsque qu’il arriva à la salle qui servait de réfectoire ; il était déjà 14h10 et Monsieur Lautron veillait à ce que personne ne s’attarde. – Encore en retard, Monsieur Alziari, tout le monde dispose du même temps de pause pour déjeuner. Il n’est pas question que chacun organise son temps cela désorganiserait la bonne marche de l’entreprise. – Mais, je n’ai pu prendre ma pause déjeuner, il fallait que je règle un problème urgent aux ateliers pour permettre à un chargement d’être livré. – Si vous étiez mieux organisé, vous auriez moins de problème d’urgence à résoudre. Vous mangerez mieux ce soir, de toute façon vous avez des réserves….. Albert, encaissa l’humiliation et retourna à son bureau travailler, après tout il récupérerait ce maudit paquet à la fin de son service à 18H. À 16h 38, il reçut la visite de Mademoiselle Lelongbec, cinquante ans, secrétaire ayant atteint l’échelon 356, c’est-à-dire le plus haut en trente ans de loyaux services dans la société. Les cheveux gris, un chignon impeccable, des lunettes à double foyer, et une silhouette courbée par tous les malheurs des autres auxquelles elle compatissait. Mademoiselle Lelongbec célibataire de longue date, était l’organisatrice en chef de tous les événements de l’entreprise : cadeaux et pots d’anniversaires, le Noël des tout petits, la collecte pour les couronnes de ceux qui avaient eu un proche décédé, la collecte pour la poussette de ceux qui avait eu une naissance, les pots de promotions, et ceux de départ à la retraite. Elle était la mémoire vivante de tous les membres du personnel administratif de la société « De La Commune et Dupont ». – Monsieur, Alziari, je fais une collecte pour le petit cadeau de la nièce de Mlle Angelia, qui vient de naître. Vous voyez qui c’est Mlle Angélia ? – Celle de la compta. Fournisseur ? – Oui, c’est cela, vous n’êtes pas obligé de donner ; je vous le rappelle, monsieur Alziari. – Albert sorti de la poche de sa veste son portefeuille, il y avait trente francs en billet de 10 francs et il les lui donna. – Au fait, à 18H15, nous faisons un petit pot pour l’anniversaire des 25 ans de présence dans notre maison de Monsieur Ramponaut, mais j’ai vu que vous y aviez déjà pensé. Encore merci pour Mlle Angélia. Albert, la congédia en saisissant le combiné téléphonique et en la gratifiant d’un large sourire. Il valait mieux être en bon terme avec Mlle Lelongbec qui pouvait influer sur l’embauche d’un CDD intérimaire en CDI. Il se replongea dans son travail…. Vers 17h 45, une idée lui traversa la tête : « Qu’est-ce qu’elle avait bien voulu vouloir dire au sujet du pot de Ramponaut ? Mais j’ai vu que vous y avez déjà pensé ? » Il réfléchit encore un moment et soudain : « Non de dieu, le paquet, d’ici quelle se pantaille, que ce sont des pâtisseries tunisiennes pour le pot de Ramponaut. Je ne suis pas dans la M…. Si je récupère le paquet dans le frigo maintenant, je passerai pour le dernier des pingres et on se demandera quels griefs j’avais envers ce pauvre Monsieur Ramponaut et ce sera la fin de mes bonnes relations avec Mlle Lelonbec, la fin de mon avenir professionnel ici. Si le paquet est ouvert sur la table, ce sera pire, un affront pour les relations sociales dans la société « De la Commune et Dupont » qui sera fatal à mon emploi et à ma réputation. Cette histoire me suivra jusqu’à la fin de mes jours, je serai marqué au fer rouge dans toutes les boites où je me présenterai. » Il se leva et couru jusqu’à la salle ou devaient avoir les réjouissances, il aperçut Mlle Lelonbec aidée de deux autres personnes en train de décorer la salle et débiter des rouleaux de papier crépon sur les tables. Il fallait trouver en urgence, quelque chose qui fasse que cette réception soit annulée. Son esprit vif trouva la solution : l’alerte incendie, un peu de fumée et l’évacuation du personnel. Il prit les escaliers intérieur de secours descendit jusqu’à l’entrée des ateliers, récupéra quelques bout de carton et de papier d’emballage, un petit sac de copeau de polystyrène. Il remonta dans les escaliers, et, arrivé au palier inférieur, fit un petit tas et y mit le feu. Il déboula dans l’étage, et cassa la vitre du dispositif d’alarme incendie, puis il revint à ouvrant la porte des escaliers et cria au feu. Un peu de fumée pénétra dans les bureaux, la sirène annonçant l’évacuation du bâtiment retenti et tout le monde se précipita vers l’escalier central. Une fois tout le monde réfugié sur le parking de l’entreprise, Albert, entra à nouveau dans le bâtiment. Il s’agissait pour lui de récupérer le paquet dans le frigo et de le balancer par la première fenêtre ouverte.

Une épaisse fumée avait envahie les bureaux, mais il connaissait les lieux, il trouva le frigo, sorti le paquet, et le jeta par la fenêtre sur le toit des ateliers en contrebas. Puis, il quitta rapidement les lieux, il faisait presque nuit maintenant dans l’open space, à cause de l’éclairage qui avait été coupé et aussi à cause de la fumée qui masquait les fenêtres. La fumée âcre le fit tousser, il rampa sur le sol, c’était un truc qu’il avait vu dans le film la tour infernale. Il butta sur quelque chose, c’était le corps d’un homme, il le traina jusqu’à l’escalier central, puis le chargea sur les épaules pour descendre les escaliers. Il déboucha sur l’extérieur, les pompiers étaient déjà sur place. Ils amenèrent immédiatement une civière et y allongèrent la victime. Aussitôt un pompier appliqua sur le visage de l’homme un masque à oxygène, pendant qu’un autre lui installait un bracelet sur le poignet relié à un appareil électronique. Le pompier annonça : « il est encore vivant. » À ce moment-là, Albert fut entouré par l’ensemble du personnel présent et longuement applaudi. Le lendemain matin, lorsqu’il vint reprendre son travail, les applaudissements redoublèrent, on lui offrit des fleurs, et les employés lui firent une haie d’honneur, en haut des escaliers Messieurs « De la Commune et Dupont » l’attendaient entourés des principaux cadres de l’entreprise, on lui montra l’exemplaire du Parisien qui citait son exploit et son action héroïque. On lui donna des nouvelles de la personne qu’il avait sauvé. Monsieur Lautron, avait fait un léger malaise vagal au moment de l’évacuation et si Albert ne l’avait pas sorti de là, il serait vraisemblablement mort par asphyxie. A la question que lui posèrent les gendarmes et plus tard les journalistes « pourquoi êtes-vous rentré à nouveau dans le bâtiment ? » Albert répondit : « Un pressentiment. »
Albert eut obtint donc son CDI et grimpa rapidement les échelons de la société « De La Commune et Dupont ». Grâce à l’argent de son salaire et les petits arrangements avec Roger, il put même se payer un appartement à l’aide d’une combine de Monsieur Maurice. Par la suite, il devint lui-même entrepreneur, racheta une entreprise sur la côte, investit dans l’immobilier, fit un peu de politique, se maria, et fonda une famille. Il eut parfois la nostalgie du petit monde du vingtième et de son Algéco alors qu’il se prélassait dans le spa de son chalet à Isola 2000.
Moralité : Si vous avez l’impression d’être dans la M…., emportez en avec vous un petit paquet, ça pourra peut-être changer le cours de votre vie.
![468 ad]()