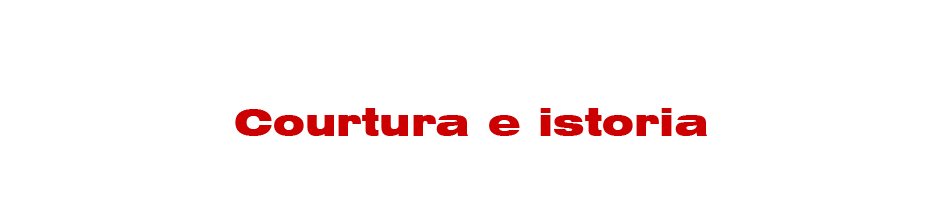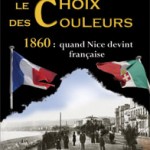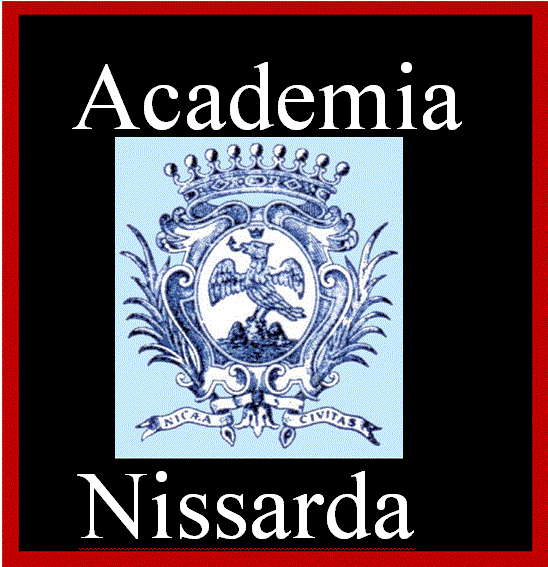Le choix des couleurs
Ecrit par J.Marie SANJORGE le 12 jan, 2014 dans la rubrique Presse / Pressa | 0 commentaires
J’ai lu pour vous le livre « Le choix des couleurs » de Louis-Gilles Pairault (aux éditions «Mémoires Millénaires » 2010) et je vous livre mes réflexions.
Si les premiers livres de la série décrivaient des événements plus éloignés dans le temps (1), nous sommes cette fois dans une proximité chronologique plus grande, celle de la deuxième moitié du XIXème siècle : l’époque du romantisme, de la Commune de Paris, de la poésie de Rimbaud ou de la tour Eiffel…
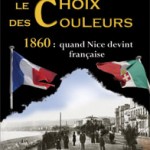
Et pourtant, quand il s’agit de notre ville au même moment, combien parmi nous demeurent dans une imprécision où se mélangent allègrement le « rattachement » à la France, la figure (vague) de Garibaldi, l’extension urbaine au-delà du Paillon, quelques souvenirs contés par les anciens ou le premier volume de la trilogie de Max Gallo (2)…

Dans ce contexte, tout travail historique ou romanesque allant dans le sens d’une meilleure connaissance est naturellement positif. C’est le cas de cet ouvrage de Louis-Gilles Pairault, précédé comme c’est la règle en cette collection d’une partie historique claire, rédigée par Alain Ruggiero.
Le roman est centré sur l’odyssée familiale de deux jeunes Niçois. Au point de départ : leur participation volontaire aux combats de 1859 dans les rangs de l’armée piémontaise, aux côtés des troupes envoyées par Napoléon III. Cette alliance, nécessaire à la monarchie du Turin dans sa volonté historique d’unifier l’Italie face à son puissant adversaire autrichien, allait permettre à la France, en échange de son aide, d’obtenir la Savoie et Nice, un an plus tard…
Nous n’avons guère l’habitude de nous retrouver plongés dans l’atmosphère de cette guerre, quelque peu oubliée du côté français, et les descriptions de l’auteur ne peuvent que passionner tout Niçois -de naissance ou d’adoption- intéressé par l’histoire du Comté ! Comme toujours en ce genre d’événement sanglant, ce mélange d’exaltation, de terreur, de souffrances sans nom et de grandeur, intimement mêlées, par-delà le bien et le mal…

Mais cet épisode, fondateur pour Giulio et Flavio, héros masculins du récit, aura pour les deux frères des conséquences opposées : passion du premier pour la liberté et l’unité du peuple italien, scepticisme et repli sur soi pour le second.
Parallèlement, nous suivons la relation sentimentale de Giulio avec la jeune Agata, l’amie de son cœur…
Là encore, mais autrement, la préoccupation civique et politique du jeune homme se heurtera à la vision strictement privée et familiale de sa compagne, axée sur une vie simple et la construction d’une famille. Visions toutes deux légitimes mais relevant d’un ordre différent, vouées normalement à s’accorder dans leur complémentarité, mais pouvant aboutir à un irrémédiable éloignement si les circonstances, comme c’est le cas ici, font diverger ces deux destinées…
Parallèlement, Agata va connaître le cheminement de bien des femmes socialement modestes de cette époque, entrant au service de riches étrangers séjournant à Nice en hiver. L’auteur nous introduit ainsi dans un monde fermé où s’agitent, s’ennuient, médisent ou se distraient Lord Heransten ou Lady Bournemouth, sujets de sa Majesté britannique, le prince Verbitskaïa et autres aristocrates russes allant et venant de Saint Petersbourg aux rives de la Méditerranée. Chez eux, l’attirance indéniable pour la lumière de notre ciel se mêle contradictoirement à un constant mépris pour notre peuple, jugé selon les cas « sale », « peu sérieux » et définitivement « incapable d’organisation »…(3)
Le destin de la jeune femme sera dévié de ce qu’il aurait dû être par le piège que constitue l’apparente « promotion » dont elle croira bénéficier dans ces milieux. On pourrait d’ailleurs se demander si l’ambiance que décrit Louis-Gilles Payrault ne conserve pas une forme d’actualité dans notre monde présent, certes de manière atténuée ? Comme l’écrivait Franco Cassano : « au sein de la rhétorique de la modernité, la Méditerranée n’a pas de salut et ne peut se libérer d’une symbolique négative. L’unique signification acceptable est celle, véhiculée par le tourisme, des splendides panoramas, des collines d’oliviers qui se jettent dans la mer, des plages de vacances où les troupes disciplinées pendant les autres mois vont s’octroyer un moment de liberté, de soleil, de redécouverte de la nature et du corps (…) Cette Méditerranée des vacances est la seule admise et la seule acceptée… » (4) 
Sans cesse, cette idée du paysage admirable peuplé de gens qui le sont moins, sauf s’ils acceptent de se transformer à l’aune du modèle anglo-saxon…
Profitons-en pour rappeler que, si l’accueil des touristes ou résidents étrangers, autrefois comme aujourd’hui (5) demeure évidemment positif d’un point de vue économique et, bien souvent, humain, il faut aussi savoir dire, en toute liberté d’esprit, que la face négative de Nice à ce propos, dès l’époque de ce roman, est d’avoir dû s’organiser méthodiquement dans le seul but de leur plaire, en négligeant parfois ce qui relève de son identité réelle et n’est donc par définition pas négociable. L’étranger, si riche soit-il, n’a en ce domaine aucune exigence à émettre : il doit prendre ou laisser, sans plus !
Il est intéressant de noter que, dans le passionnant ouvrage qu’il a consacré par ailleurs aux relations de Nice et de Garibaldi (« De l’abeille au ruban bleu » éditions Serre 2008), le même Louis-Gilles Pairault a pu écrire : « Garibaldi n’était jamais retourné à Nice après 1859 (…). Ce révolutionnaire absolu pouvait-il voir d’un œil heureux sa ville natale –déjà arrachée à la patrie italienne dont il avait été l’un des plus ardents défenseurs- devenir le lieu de villégiature de tous les privilégiés de la terre ? »
L’un des épisodes du roman fait assister à une partie de « l’épopée des Mille » menée par Guiseppe Garibaldi et aboutissant, par un pur acte de volontarisme politique, au rattachement de la Sicile et de Naples au royaume d’Italie. La grandeur de Garibaldi, outre le courage dans l’action et le total désintéressement, fut de savoir mettre au second plan ses orientations idéologiques personnelles (qui resteront foncièrement républicaines) au profit d’une haute conception de l’indépendance de son peuple, ce qui le conduisit à l’alliance avec la monarchie piémontaise face à l’adversaire commun. Ce que ne sut pas faire Mazzini, figure du socialisme européen de son époque, d’abord inspirateur de Garibaldi, puis rival à la stratégie opposée…

Puisque nous parlons de Mazzini, faisons un petit aparté….
[Giuseppe Mazzini, né à Gênes, emprisonné dès les événements de 1830 pour ses activités républicaines puis contraint à l’émigration, fonda des sociétés révolutionnaires : la “jeune Italie” élargie ensuite à la « jeune Europe ». Représentant caractéristique des mouvements de 1848, il participa à la direction de l’éphémère république romaine. Nationaliste romantique mais ouvert à l’idée européenne (il parla de « sainte alliance des peuples »), il s’opposa violemment, ce qui est passionnant, à l’utilitarisme anglo-saxon et au matérialisme marxiste : « Faire de la théorie du bien-être le but de la transformation sociale, c’est déchaîner les instincts de l’individu qui le poussent vers la jouissance, développer l’égoïsme dans les âmes et considérer les appétits matériels comme une chose saine. Une transformation basée sur de tels éléments ne peut être durable, et c’est contre ces tendances que nous dirigeons aujourd’hui nos efforts …»
Réservé vis-à-vis de la philosophie des droits de l’homme érigés en absolus (il fut l’auteur d’une brochure intitulée significativement « des devoirs de l’homme »), il écrivit dans un autre opuscule (« foi et avenir ») : « le droit, c’est la foi individuelle ; le devoir, c’est la foi commune. Le droit ne peut aboutir qu’à organiser la résistance ; il n’a mission que pour détruire ; il n’en n’a pas pour fonder : le devoir fonde et associe (…) la doctrine des droits ne renferme pas par nécessité le progrès (…) Tout ceci, c’est le XVIIIè siècle : la servitude aux vieilles choses s’entourant des prestiges de la jeunesse… »
L’intransigeante pureté de ses conceptions l’empêcha, au contraire de Garibaldi, de faire preuve du sens politique qui lui aurait permis d’admettre le rôle que le roi Victor-Emmanuel jouait dans la construction de l’Italie. Cet événement majeur pour l’Europe se déroula sans lui… ]
]
Pour en revenir à notre roman, il est malgré tout un domaine où l’auteur du « choix des couleurs » va faire une large concession à l’esprit de notre époque, abandonnant ainsi toute vision « garibaldienne » : celui de l’opposition constante qu’il met en scène entre l’engagement (représenté par Giulio, militant de l’unité italienne) et l’individualisme des intérêts privés (qui est celui de Flavio et d’Agata).
L’on sent bien par-delà les nuances qu’il est certes capable d’établir que Louis-Gilles Pairault approuve la « rassurante » et simple aspiration au bonheur personnel que prônent le frère et l’amante, face à l’excès toujours « dangereux » que l’on ressent par exemple chez Gennaro, l’activiste garibaldien, dont l’influence sur Giulio est considérée comme constamment inquiétante.
Cette problématique mérite à mon avis d’être au moins relevée et discutée ! Car je sais que beaucoup ne doivent même pas la percevoir, tant est puissante l’apparente évidence du bon sens tranquille et dépolitisé que valorise indirectement l’auteur… La tendance à la passivité qui existe en nous tous a toujours été l’arme des systèmes établis, pour que finalement, rien ne change …
L’élan de Garibaldi est pourtant bien différent, quelles que soient les limites ou les naïvetés de l’époque : hommage à lui ! 
Mais merci aussi à Louis-Gille Pairault d’avoir su positionner, au travers de ses personnages, la réalité d’un tel enjeu…

Jean-Marie Sanjorge
(1) Aux éditions «Mémoires Millénaires » : « Là où la terre touche le ciel » par Fabrice Anfosso (préhistoire) ; « la 8ème colline de Rome » par Ugo Bellagamba (antiquité) ; « le manuscrit de la porte » par Fabrice Anfosso (moyen âge) ; « le dernier rempart » par Fabrice Anfosso (fin XVIIème, début XVIIIème siècle).
(2) « La baie des anges » par Max Gallo (éditions Laffond). T1 : « la baie des anges » ; T2 « le palais des fêtes » ; T3 « la promenade des Anglais ».
(3) On lira avec plaisir, dans un esprit totalement opposé, l’opinion de Frédéric Nietzsche écrivant à propos de la culture de Nice : « Quelque chose de victorieux (…) s’en dégage, quelque chose de très réconfortant qui me dit, ici tu es à ta place… »
(4) Dans « la Méditerranée italienne » par Vincenzo Consolo et Franco Cassano (éditions Maisonneuve & Larose 2000). Très finement, Franco Cassano écrit ensuite que même la fierté méditerranéenne, dont il note avec satisfaction le retour, peut comporter un risque : « c’est la Méditerranée des hôtels qui en portent le nom et en défigurent les plages et les collines, la Méditerranée du rouble, celle qui sert de faire-valoir à de petits caïds de province, celle qui devient l’apologie d’une marginalité qui engraisse à l’ombre de sa médiocrité et qui voit dans l’identité méditerranéenne une amnistie pour toute ses spéculations (…) la Méditerranée qui se boursoufle et sert d’adjectif pour tout, même pour les choses les plus ignobles, utilisée comme une feuille de vigne pour couvrir ceux dont on devrait rougir… »
(5) Désormais, dans notre région, l’équivalent de la population étrangère décrite dans le roman est essentiellement constituée de cadres d’entreprises ou de rentiers en tous genres.
![468 ad]()