Culture populaire contre culture de masse
Ecrit par Eric FONTAN le 11 mai, 2011 dans la rubrique Presse / Pressa | 2 commentaires
Au delà des articles traditionnels dans notre site sur la culture Niçoise, sur les notions de peuple, sur la critique du monde moderne destructeur des cultures les plus anciennes, nous avons redécouvert un auteur d’Outre-Atlantique, Christopher Lasch, qui a pondu un ouvrage qui nous paraît fondamental et qui a été traduit en français.

Nous ne pouvions vous laisser dans l’ignorance de cette œuvre essentielle qui rejoint en tout points nos préoccupations en différenciant de façon argumentée la culture de masse, produit du monde moderne individualisé et de son avatar la société de consommation, et la culture populaire, qui se traduit par une persistance de l’expression des façons d’être au monde des peuples et de leur cohésion communautaire.
Claude Bourrinet a produit une analyse très intéressante de ce livre, analyse que nous vous livrons ici:
Jean-Claude Michéa, dans le même temps qu’il éclaire de façon érudite et rigoureuse les esprits encore libres de ce temps d’aveuglement généralisé, se fait l’inlassable passeur d’un grand penseur d’outre-Atlantique, Christopher Lasch, plume lucide et caustique, qui prouve que l’Amérique a pu produire, avec les formes les plus abrutissantes de la modernité, la critique qui la nie. Ce travail de présentation d’une réflexion nous a valu de beaux livres, comme La Révolte des élites, ou La Culture du narcissisme, entre autres, que Jean-Claude Michéa a préfacés, de même qu’il nous présente substantiellement un texte, qui fut rédigé en 1981 dans la revue Democracy sous le titre « Mass culture reconsidered », dont la traduction française, parue aux Éditions Climats, adopte celui, hautement significatif, de Culture de masse ou culture populaire ?.

L’opposition entre « masse » et « peuple » a le mérite, plus que le titre anglais, qui évoque une démarche intellectuelle, d’impliquer brutalement le champ politique. Ce qu’elle sous-tend est un engagement profond au service d’une vision que l’on pourrait appelée « républicaine », au sens que la vieille Amérique, celle du XIXe siècle, lui donnait, et qui était encore proche de celle qui était défendue en Europe, mais chargée sans doute de plus d’optimisme. En effet, Lasch, contrairement peut-être à une tradition héritière de l’Ancien Régime, singulièrement en France où les « antimodernes » étaient richement représentés, a toujours attaché, jusqu’à sa mort, une foi inébranlable dans le combat pour les classes populaires. Et il nous montre comment cet idéal, qui devait rendre la société meilleure, plus solide, plus riche humainement, plus solidaire, avait été trahi par ceux-là mêmes qui en avaient été les hérauts, cette frange « éclairée » de la bourgeoisie, qui porte volontiers un regard paternaliste et condescendant sur ces couches prétendument hostiles aux formes savantes de la culture. Il n’est certes pas inintéressant de connaître certains théoriciens américains de la culture, comme John Dewey, réformateur antiautoritaire de l’enseignement, Thorstein Veblen, qui louait les effets « émancipateurs » de l’activité industrielle, et bien d’autres, comme Dwight MacDonald, beaucoup plus critiques qu’un Herbert Gans, dont la niaiserie « démocratique » frise l’indigence publicitaire, ou qu’un Randolph Bourne, « précurseur des actuels défenseurs de la conscience ethnique et de la diversité culturelle ».

Deux volets paraissent se succéder dans ce petit livre, à première vue dissemblables, en tout cas appartenant à des sphères différentes : celui consacré à la culture, en l’occurrence celle que l’on destine, ou que l’on prête aux masses; et celui des médias, de la communication. Mais Christopher Lasch démontre que ces deux vecteurs de la société contemporaine, non seulement détiennent une importance capitale pour le projet qu’entretiennent les élites de contrôler efficacement le corps social, prévenant ainsi la guerre civile, comme l’indique pertinemment Régis Debray, dont le théoricien américain s’inspire parfois, mais aussi sont intimement imbriqués, tant la « culture » est devenue une affaire médiatique, fondée sur la publicité, la posture, l’esbroufe et le vide. Lasch montre même que le combat politique a pris le ton de cette culture de masse, faite d’annonces, de chocs, d’effets de miroirs, de clowneries (il cite Mark Rudd, Jerry Rubin et Abbie Hoffman, mais nous pourrions tout aussi bien invoquer les noms illustres de la carnavalesque « révolution » de 68, dont certains leaders ont bien fait leurs affaires), et que ce « style » fondé sur la fugacité de l’image et du son s’aligne intégralement sur la vérité marchande du capitalisme contemporain, fait de flux, de conditionnement, de légèreté idiote, et surtout de choix fallacieux, car puérils et grossiers.

L’intérêt de cet écrit vieux de maintenant trente ans, outre qu’il fut perspicace en son temps, n’est pas de nous apprendre l’intrication entre le monde de l’économie et celui d’une culture de masse qui nie toute véritable liberté, et se réduit à des productions uniformes, pauvres et de plus en plus se confondant avec le Diktat mercantile. Les théoriciens de l’individualisation de la dilection artistique revendiquent un démocratisme radical, relativiste et antiautoritaire, hostile au monde ancien, à tout ce qui relève du passé, égalitarisme dont la gauche s’est fait le champion, contre un prétendu capitalisme patriarcal, misogyne, répressif et étouffeur de créativité. Nous savons maintenant qu’il n’en est rien, et que le capitalisme est le plus formidable destructeur de traditions et d’autorité qui ait existé. Aussi Lasch manie-t-il une ironie roborative, mettant les intentions en face des réalités, la rhétorique « rebelle » avec les résultats dévastateurs d’une politique culturelle qui vise à mettre l’individu face à des désirs indéfinis et à la mesure de ses (pauvres) rêves (comme nous l’enjoignit un slogan fameux de 68). Au lieu de la liberté, l’esclavage; au lieu de la réalisation de soi (autre utopie puérile), le narcissisme et l’auto-congratulation; au lieu d’un monde bâti en commun, une addition d’atomes erratiques mirant leur abîme de misère. L’univers de 1984 s’est imposé, voilant, enfumant, travestissant les valeurs.
Pour autant, Christopher Lasch ne se réclame pas, comme Dwight MacDonald, d’une séparation radicale entre la culture de l’élite et celle des classes populaires, ce qui induirait une forme de ségrégation, et, en définitive, une stérilité générale, travers que l’on constate d’ailleurs chez les théoriciens de l’École de Francfort, Max Horkheimer, T.W. Adorno, lesquels critiquaient la culture populaire au nom de la culture savante (Adorno méprisait le jazz, par exemple); il ne partage pas non plus l’ancienne illusion progressiste d’une « évangélisation » culturelle de peuple, censé végéter dans son obscurantisme indécrottable et dans ses superstitions malsaines, préjugé issu des Lumières, lesquelles désiraient l’élever à la maturité politique (c’est-à-dire au progrès).
Le point crucial de sa réflexion, et son originalité, tiennent à l’analyse de la modernité comme arrachement des racines, des modes d’existence qui étaient liées à une mémoire, un groupe, une classe, et qui se prévalaient d’habitudes, de pensées, d’arts qui devaient autant aux familles qu’aux métiers, dont beaucoup étaient artisanaux, qu’à toutes espèces d’appartenances, celle des amis, des terroirs, des activités de tous ordres, et, plus généralement, aux traits caractéristiques des ensembles dans lesquels la personne se coulait sans s’anéantir. C’est justement ce vivier, cette incalculable, incomparable expérience populaire, cette richesse multiséculaire, qui ont été arasés par la gestion bureaucratique et marchande des égos et des pulsions, par une éducation sans caractère, universaliste et mièvre, un traitement technique des besoins et souffrances humains. Les familles éclatent, les générations ne se transmettent plus rien, le nomadisme, vanté par l’hyper-classe, est méthodiquement imposé, les lavages de cerveau sont menés par la télé et des films idiots, la société de consommation abaisse et uniformise les goûts, instaure un totalitarisme d’autant plus efficace qu’il sollicite un hédonisme de bas étage. Ces danses, ces chants, cette poésie authentiques des anciennes sociétés rendaient plus libres, plus autonomes et fiers de soi que cette production « artistique » qui ressemble tant aux produits de la publicité, lesquels visent à rendre les cerveaux malléables et les cœurs mélancoliques. Le temps où une véritable création populaire irriguait celle des élites, à charge de revanche, comme on le voit par exemple dans les œuvres de Jean-Sébastien Bach, et précisément dans les grands chefs d’œuvres, semble révolu, détruit complètement par la barbarie marchande.
Claude Bourrinet
• Christopher Lasch, Culture de masse ou culture populaire ?, Éditions Climats, coll. « Documents et essais d’actualité », 2011, 75 p., 7 €.

Nous ne pouvons qu’adhérer à cette analyse en pensant à la société que nous proposent ceux qui décident pour nous dans le Comté de Nice et qui privilégient l’art moderne spéculatif dans le pays qui a vu naitre les « Bréa », qui financent des produits comme la Techno sans racines plutôt que de promouvoir la musique populaire de notre Pays, bref, qui dans le domaine culturel nous imposent des produits de consommation standardisés telle cette œuvre scatologique de métal rouillé qui défigure la façade de notre ville. Nous, pour notre part, nous serons toujours du côté de la culture populaire et enracinée.
![468 ad]()

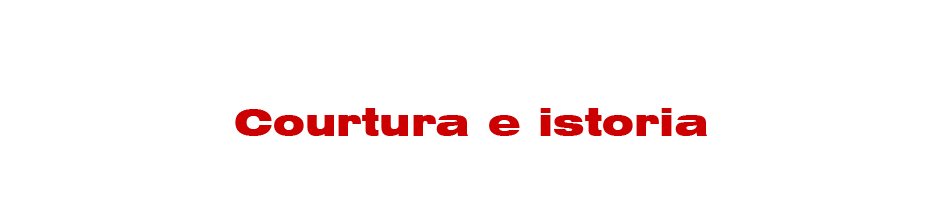










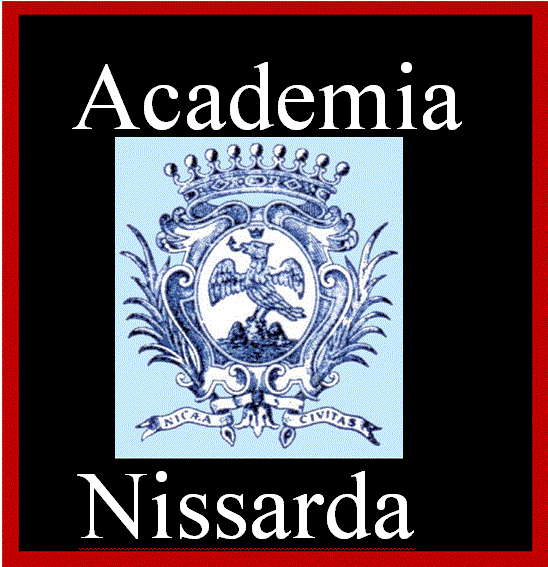













Fier d ‘ être « catalan » , je le suis aussi d ‘être des vôtres ! Sempré en dabant, may morirem !
(toujours en avant , jamais on mourra ! »
Cristià membre de Nissa Rebéla
Car Cristià, aves rasoun d’estre fier d’estre Catalan coume iéu siéu fier d’estre Nissart. Il est vital de défendre nos cultures face au jacobinisme de l’état français, comme il est vital de défendre toutes les cultures face au système à tuer les peuples qu’est le « Marché Mondial » enfant naturel du capitalisme sauvage et destructeur. Un petit bémol, si vous permettez, Cristià, je ne pense pas que les défenseurs de l’indépendance de la « Catalunya » se compromettent avec des partis nationalistes espagnols. Vous dites que vous êtes à « Nissa Rebela », c’est votre choix, je le respecte…mais si vous êtes un défenseur de la Catalogne libre, cela est antinomique avec le fait d’adhérer à un parti qui est allié avec des partis ou mouvements franco-français: à un certain moment il faut faire un choix pour être cohérent. E Viva Catalunya libre e Viva Nissa libre. Je vous rappellerai notre devise » Ni…destra, Ni…seneca, Ni…ssart soulamen ! » ou encore « Ni Francès, Ni Italian, Nissart »